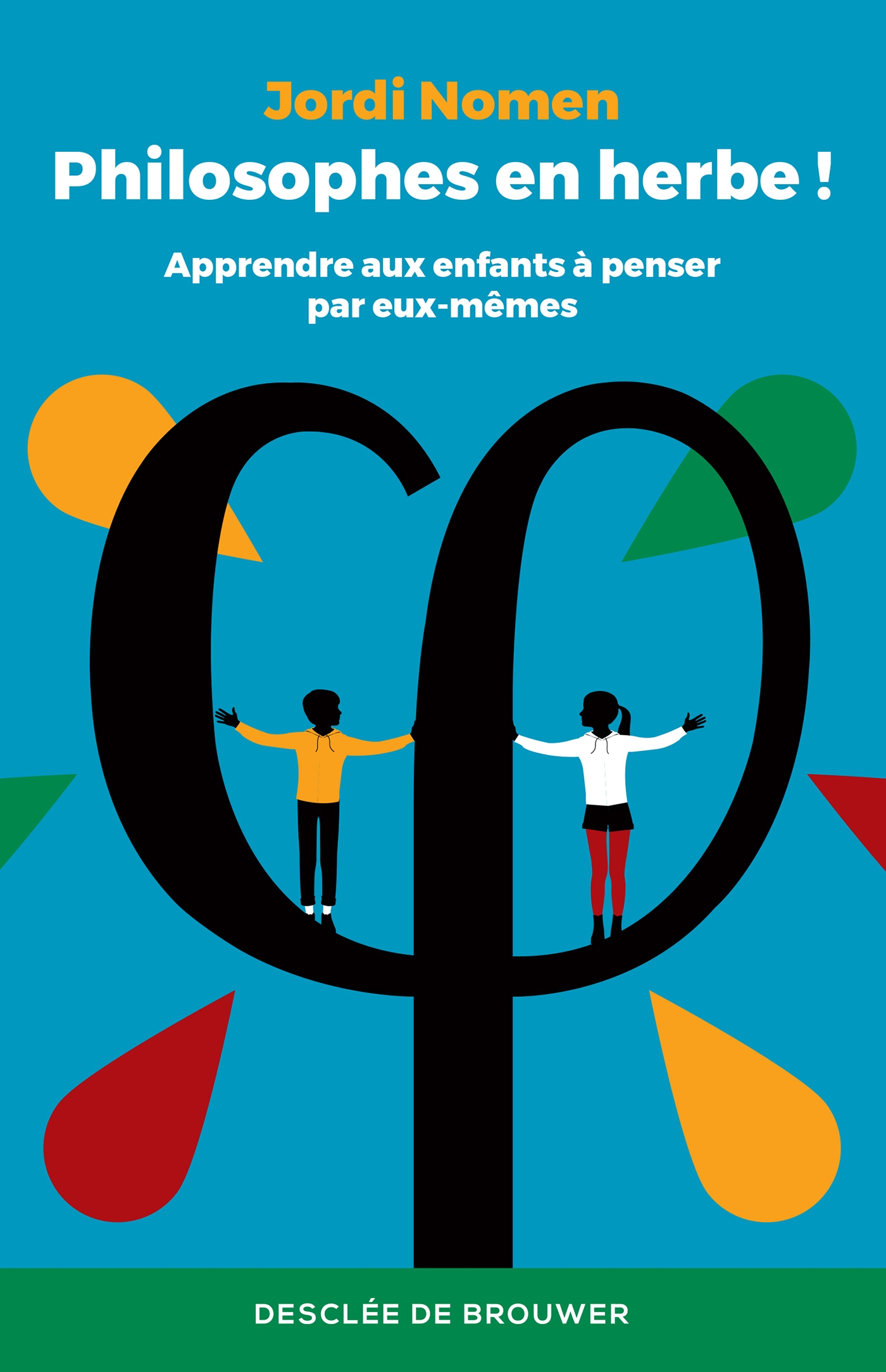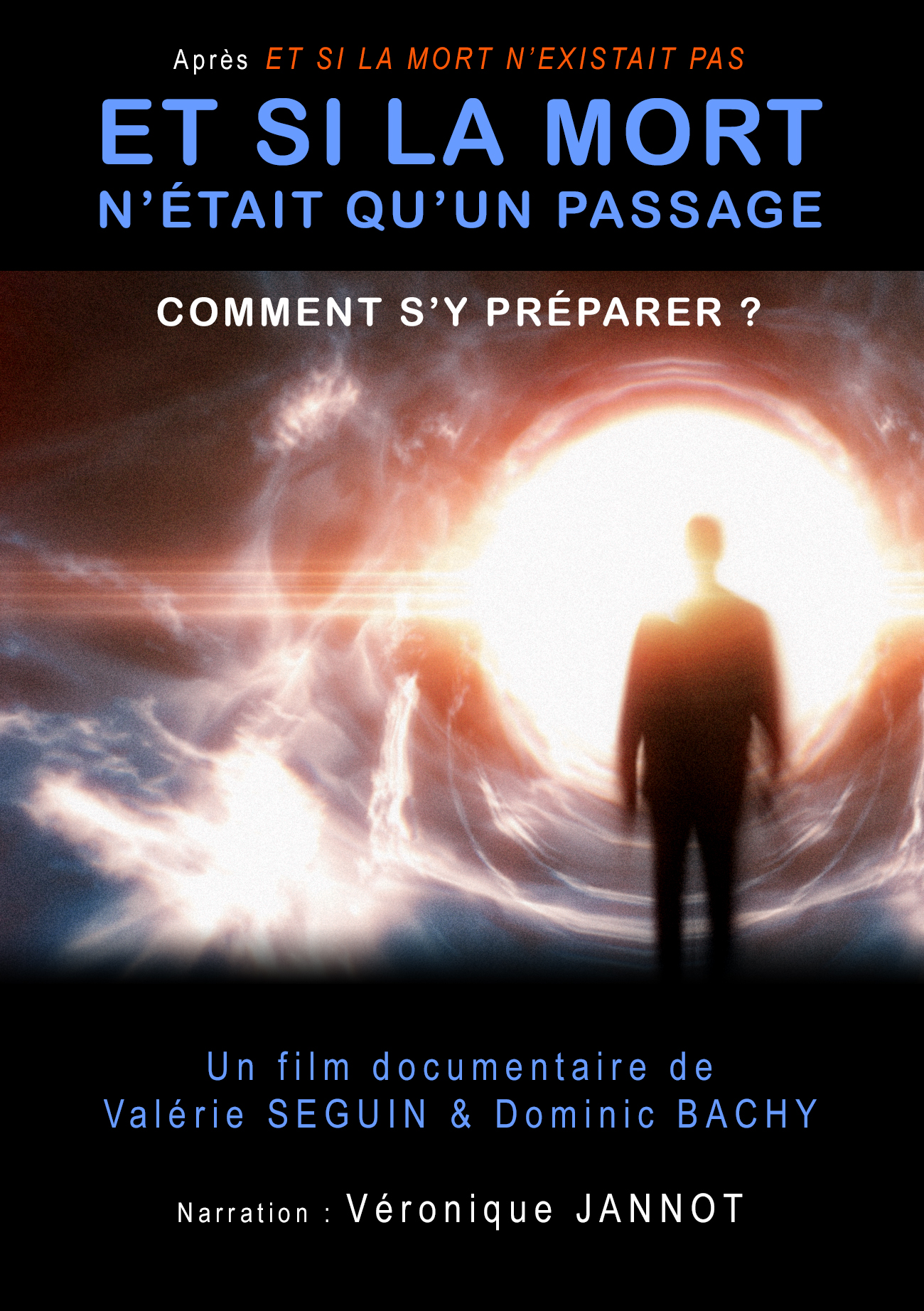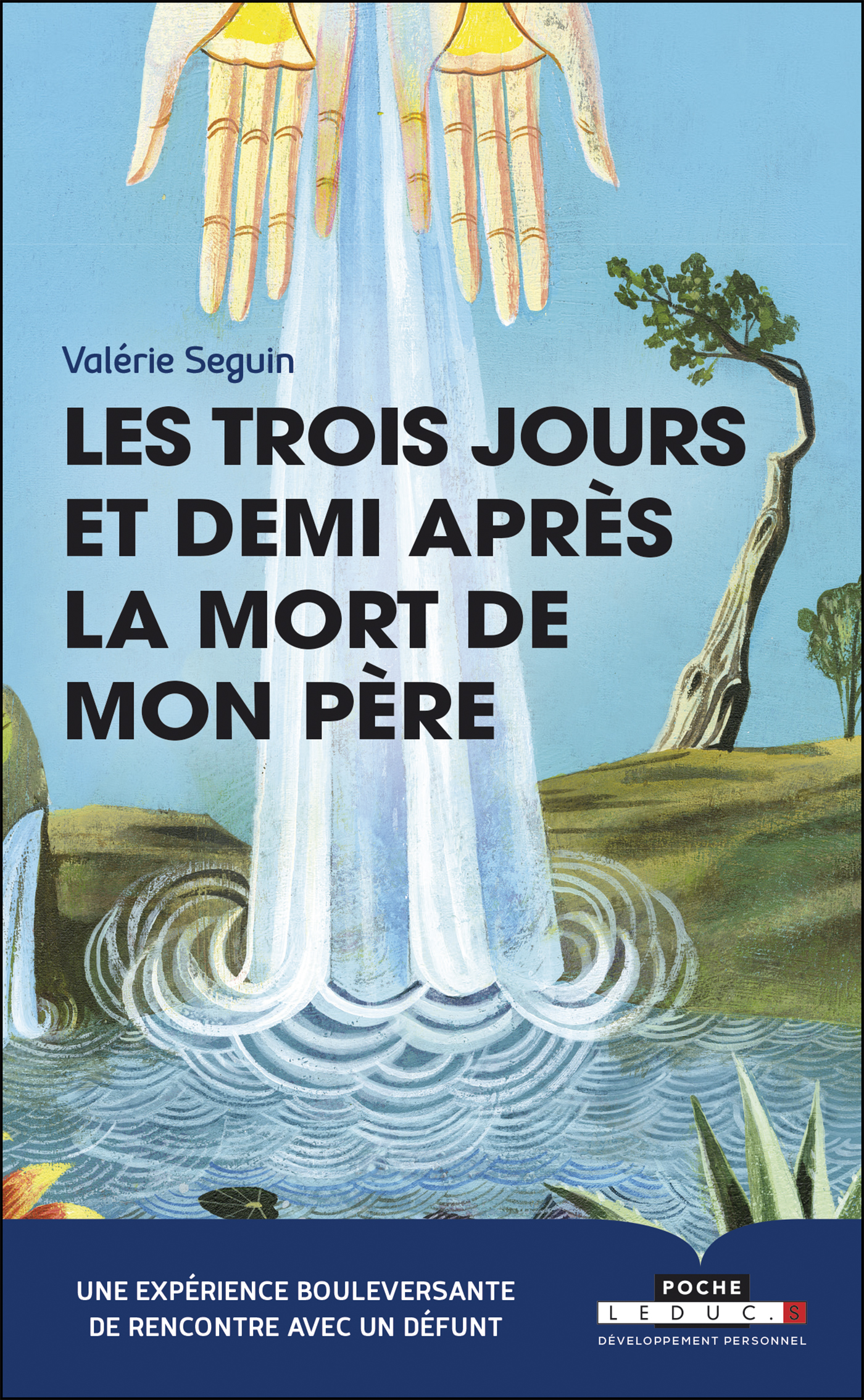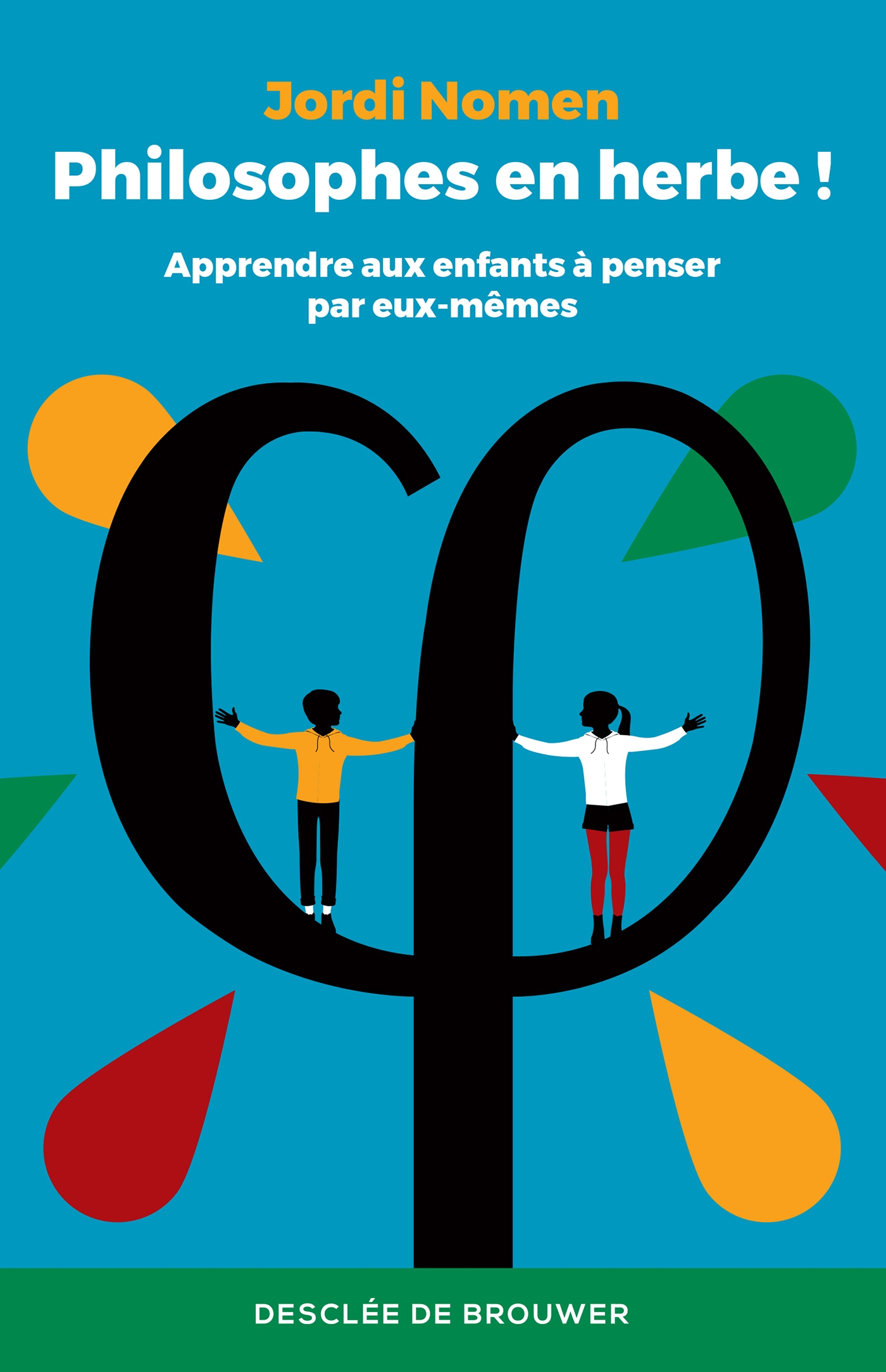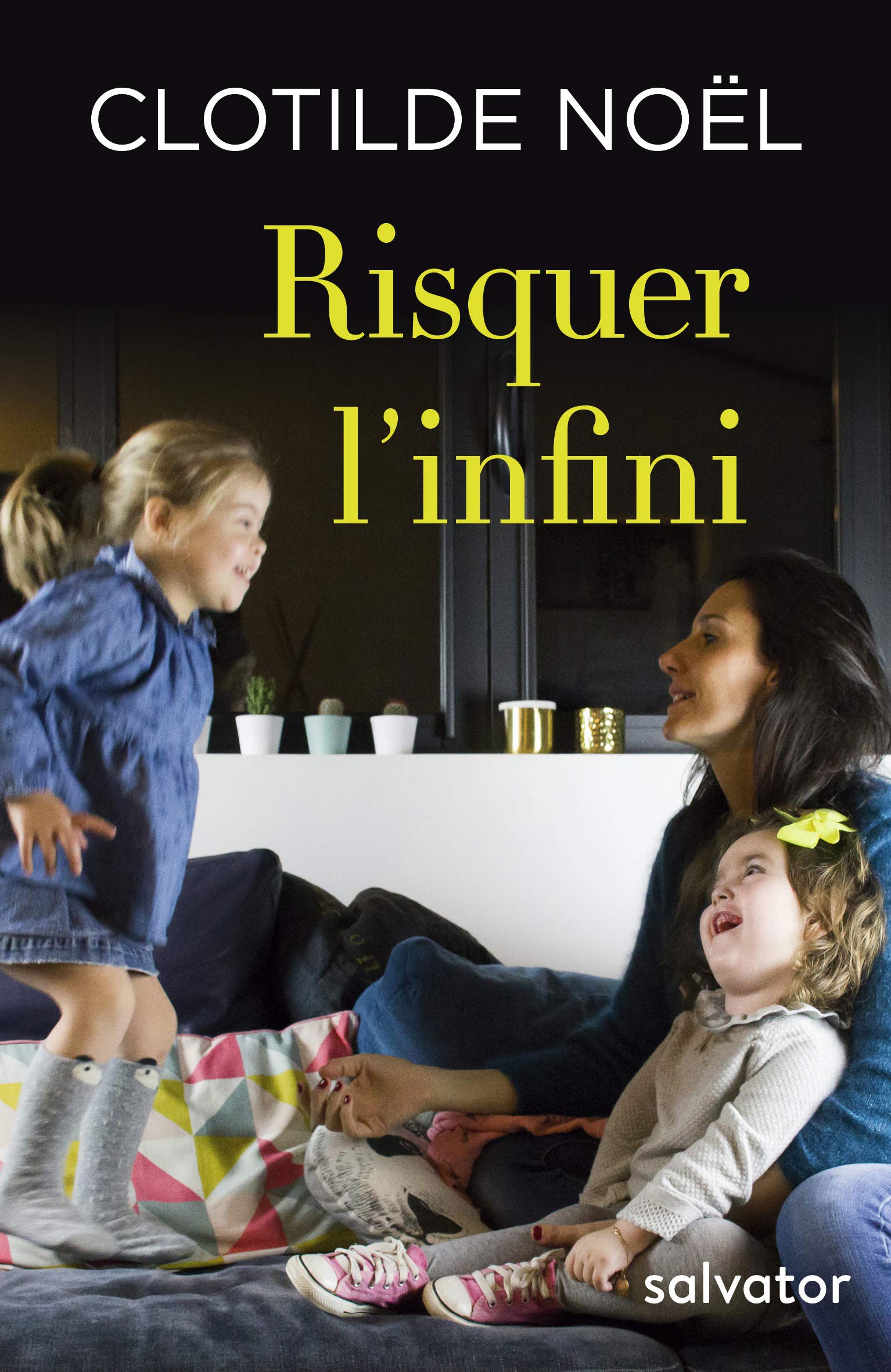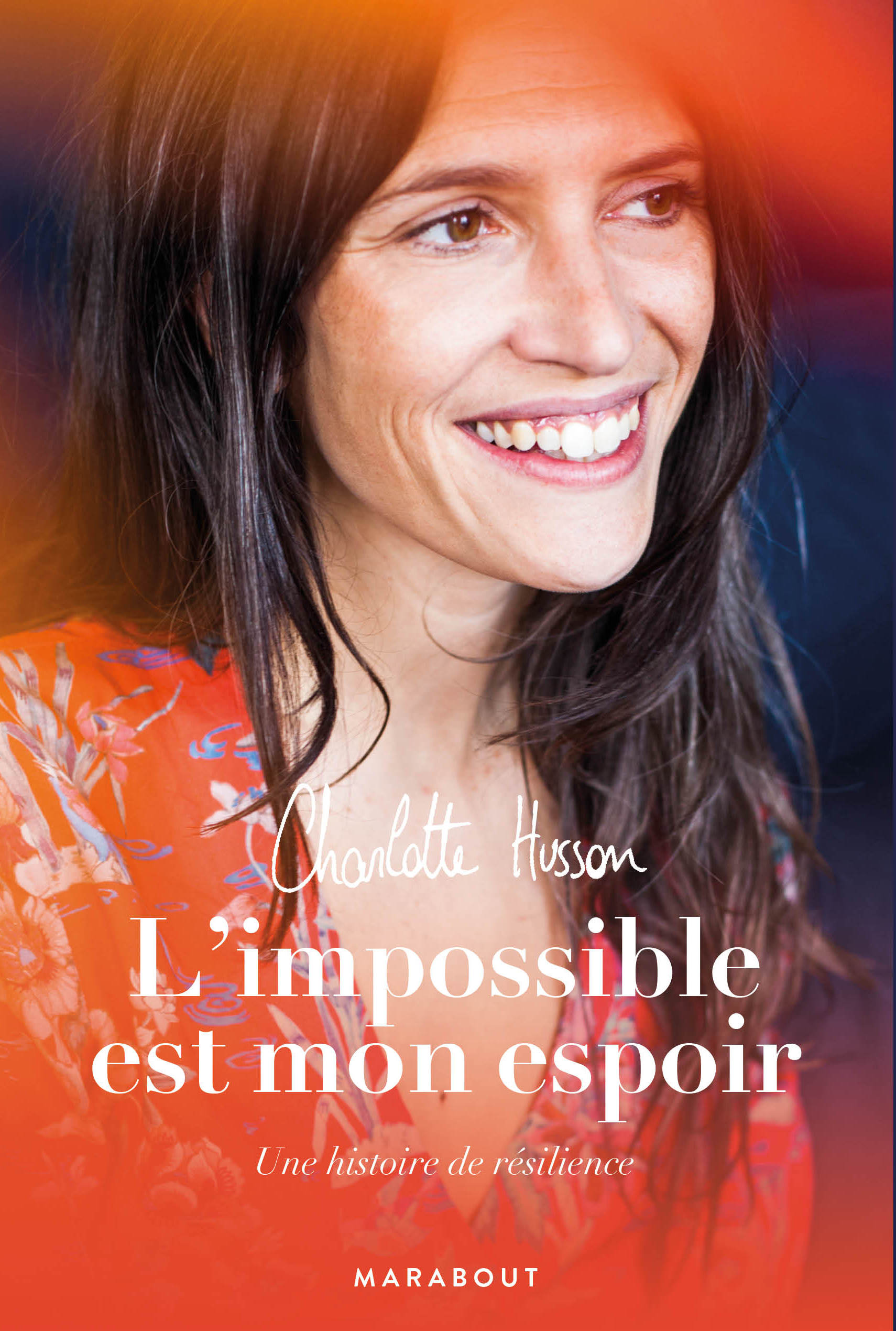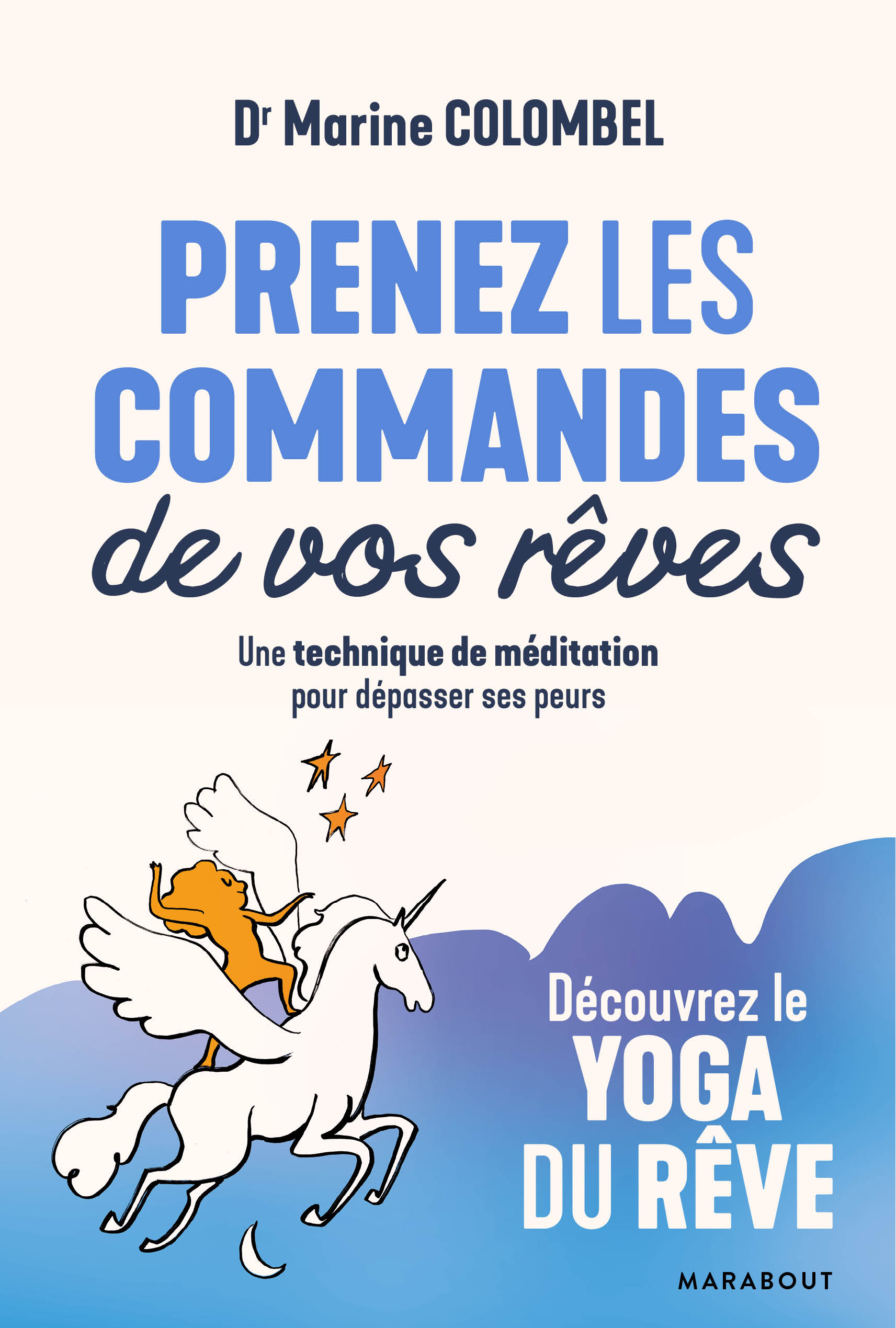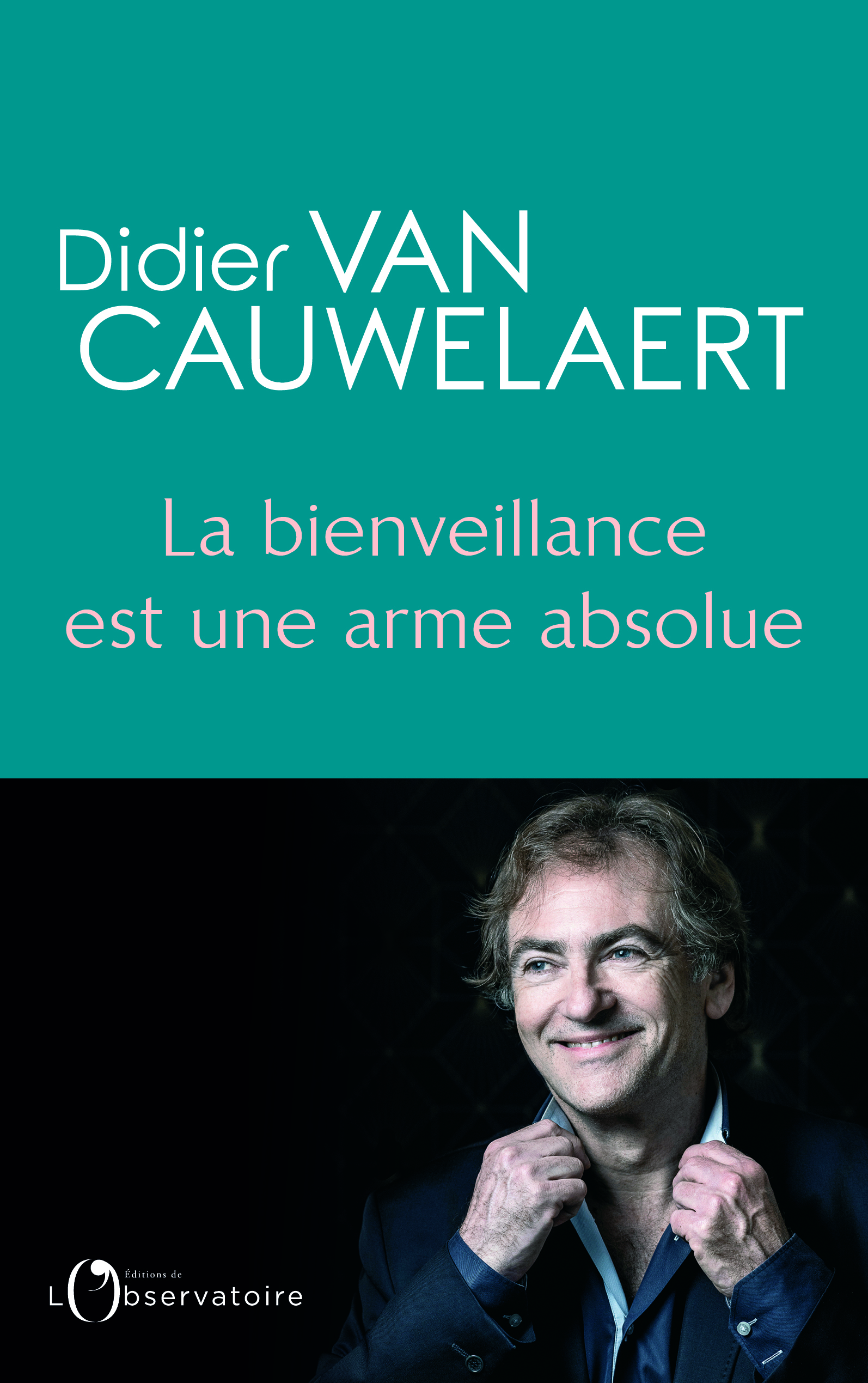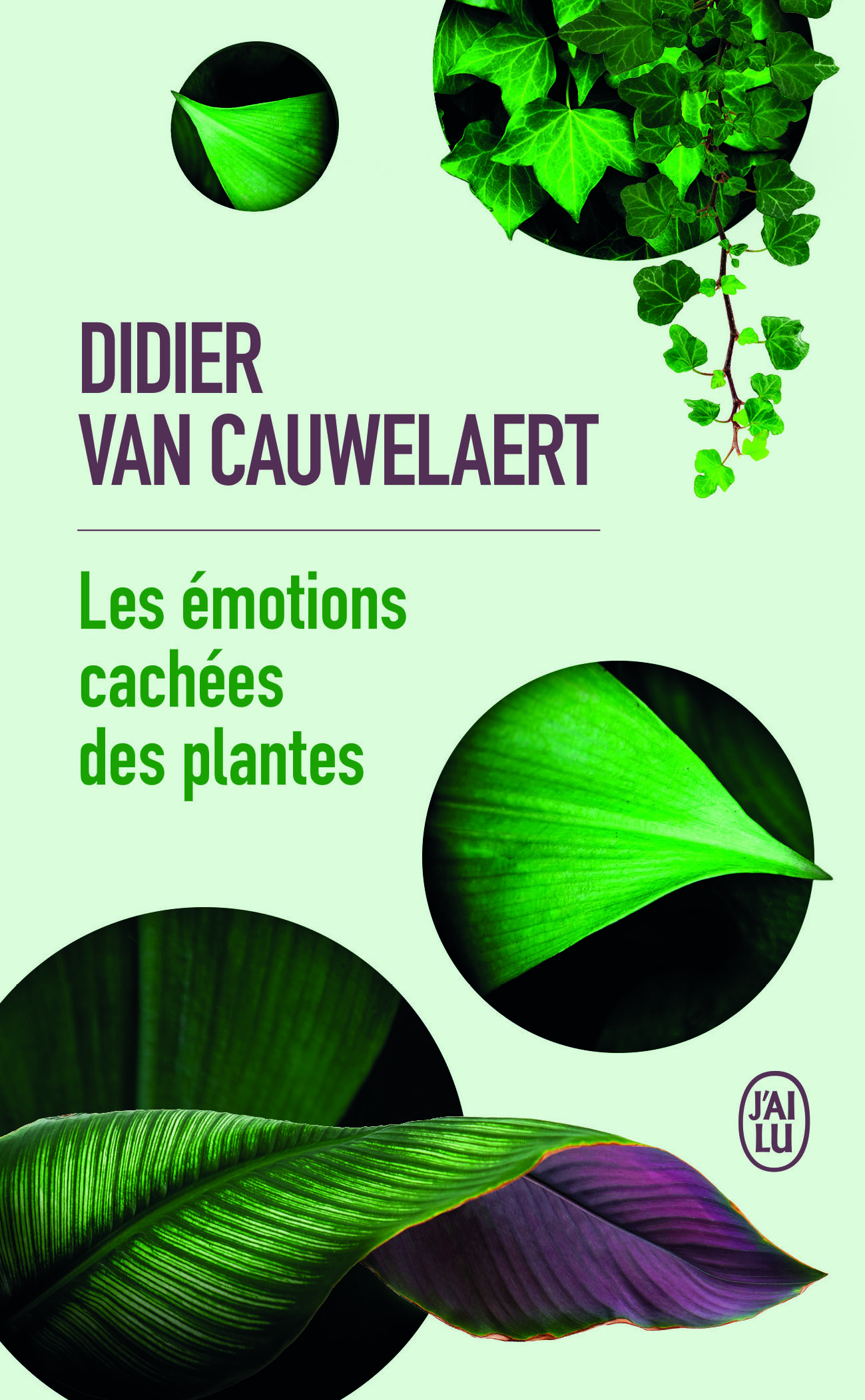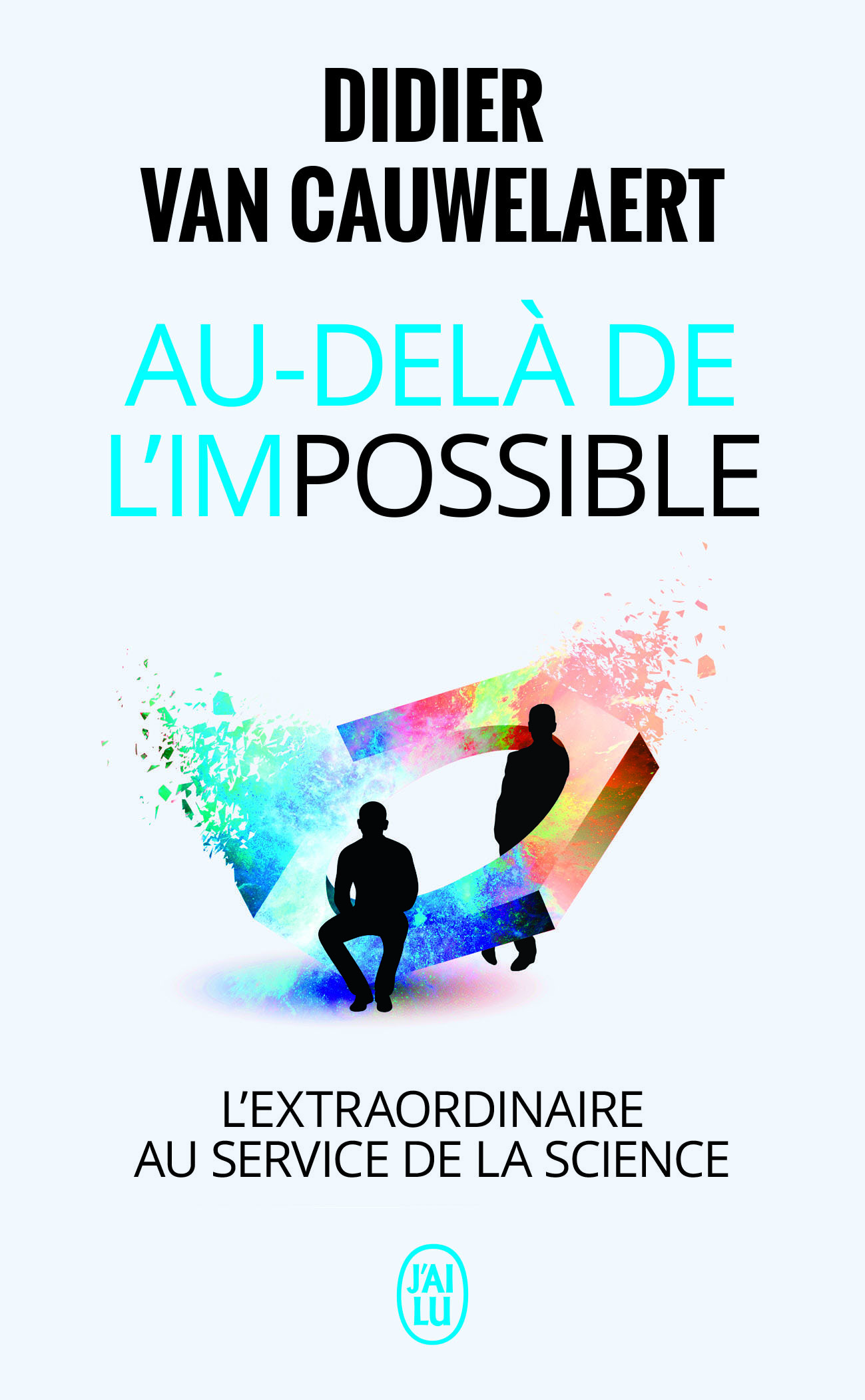Happinez : Pourquoi devrait-on enseigner la philosophie aux enfants?
Jordi Nomen : La philosophie pratique que je défends sert à susciter chez les enfants une pensée critique, créative et éthique, à les aider à mieux penser, à mieux agir. Mais, définissons ce “mieux”.
La philosophie sert avant tout à faire travailler la pensée critique, même chez les enfants. La pensée critique est une pensée habile et responsable qui facilite le jugement. C’est une vertu intellectuelle et de caractère. Intellectuelle car elle comprend les compétences nécessaires pour formuler des arguments et utiliser correctement le langage sans sous-estimer le contexte ou la réflexion avec les critères appropriés. Et de caractère, en tant qu’elle génère des attitudes stables et durables telles que l’empathie, l’honnêteté et l’humilité.
Si nous apprenons à penser par nous-même, nous trouverons les critères sur lesquels fonder les nouvelles étapes, intentions, causes, conséquences, circonstances, moyens, valeurs. Avec ces outils, nous allons prendre des décisions et analyser les succès et les erreurs, après avoir géré les émotions qui filtrent notre regard. Et finalement, nous allons comprendre que la liberté est davantage intérieure qu’extérieure. Ensuite, nous allons devoir assumer le fait que sommes des êtres responsables et que nos décisions nous façonnent. Une bonne raison pour travailler la philosophie avec les enfants… et avec tous le monde.
De la même manière que la philosophie chez les enfants peut éduquer le sens critique, elle peut également leur permettre d’élaborer leur échelle de valeurs d’une manière plus lucide et plus solide. Les questions de valeur seront présentées naturellement. Que peut-on considérer préférable ou plus important dans cette solution ou dans celle-la ? Analyser le pour et le contre, la force des arguments cachés dans les jugements de valeur qu’ils peuvent émettre, ainsi que les fondements argumentatifs et leur cohérence, leur permettra de mieux choisir leurs valeurs et de les défendre. Ainsi, il est clair que partager des opinions et leur analyse commune nous permet d’apprendre l’empathie, le respect, la tolérance et de considérer la possibilité d’une erreur comme un lien précieux dans notre propre apprentissage. Sans surprise, Plutarque a établi que le cerveau n’est pas un verre à remplir, mais une lampe à éclairer.
La philosophie pour enfants établit également un apprentissage de la créativité, car la confrontation des idées nous oblige à donner des exemples, à rechercher des analogies qui rendent l’argument que nous voulons soutenir plus compréhensible. Bref, sortir de la zone de confort pour explorer la complexité et questionner ce qui vient à l’esprit sans aucune solidité ni cohérence. Nous devons choisir le langage et comprendre la réalité dans toutes ses nuances pour pouvoir choisir la meilleure façon de penser, d’agir. Nous devons garder à l’esprit que personne n’a une conception absolument cohérente de la vie et du monde. Il y a des doutes, des questions qui apparaissent lorsqu’un problème survient et qui nous incitent à le résoudre. Et il n’y a pas un seul chemin non plus. Les itinéraires sont variés et il faut peser le pour et le contre. Malgré tout, la pensée créatrice sera un bon moyen de résoudre des problèmes et des conflits qui ne se sont pas encore posés et que nous ne pouvons pas deviner. Dans notre société de communication et d’information, nous n’aurons pas de difficultés pour accéder aux données, mais plutôt pour les combiner de manière nouvelle, créer des modèles différents pour résoudre divers dilemmes. La pensée créative permet à l’esprit de s’habituer à parcourir d’autres routes, autres que celles de d’habitude, et sert de moteur à de nouvelles idées que la pensée critique pourra ensuite évaluer. Elles se complètent. Et ainsi, il convient de se demander : voulons-nous des enfants et des étudiants critiques, créatifs, respectueux, libres ? Voulons-nous accompagner les enfants dans leur lutte pour grandir ?
Et que peut faire la philosophie, en somme, pour nos fils, nos filles et nos étudiants? Peut-être que la philosophie élargit le monde des questions que la science n’atteint pas. La science demande comment préserver la santé, mais pas si la santé est la condition préalable de la joie, par exemple. La philosophie met en contact les grands et les petits, le fini avec l’infini, le cosmos et le chaos, le relatif avec l’absolu, dans une tension de la raison humaine qui l’aiguise et la perfectionne. En fin de compte, la philosophie est inutilement « utile », selon certains qui croient avoir toutes les réponses sans savoir que seul l’ignorant peut tout savoir, puisqu’il ne connaît pas l’ampleur de ce qu’il ignore. Rien à apprendre ! Peut-être devraient-ils invoquer Socrate qui déclarait qu’il ne savait pas grand chose et que le peu qu’il savait le concernait lui-même. Peut-être que la philosophie leur est peu utile en dehors des études, ou peut-être que les études sont peu utiles si la philosophie a disparu !
Tous les enfants se posent des questions fondamentales telles que « Qu’est-ce que le moi ? », « Pourquoi le monde existe-t-il ? », « Pourquoi devons-nous mourir ? » « Y a-t-il un destin ? » Adultes, nous nous souvenons de la perplexité que ces questions ont généré en nous, à un moment ou à un autre, et de la véhémence avec laquelle les enfants nous demandent une réponse concluante que nous sommes d’ailleurs incapables de leur donner. Dans les jeux, les mythes et les questions, ils recherchent un guide qui les oriente dans la recherche du sens. Nos enfants doivent développer une réponse critique et créative aux défis que le monde actuel leur pose, dès leur plus jeune âge, mais ils doivent également construire une éthique qui prenne en compte la pluralité des valeurs existant dans le monde et qui facilite leur coexistence, c’est pourquoi nous devons également leur inculquer un troisième aspect de la pensée qui est la prudence. C’est cette pensée prudente qui se préoccupe de la correction de notre pensée du point de vue de nos valeurs et qui montre un engagement actif entre pensée, parole et action. Une réflexion attentive valorise et évalue, en accordant de l’importance à son contenu et en appliquant des jugements de valeur qui contiennent une forte composante émotionnelle. La pensée prudente est active, reconnaissante, normative, affective, empathique. Il y a des raisons qui ne sont pas des causes et les émotions ne sont pas simplement des impulsions physiologiques. Pour décider ce que nous aimons et ce que nous n’aimons pas et pour réagir face à cela, il faut faire preuve de jugement, et nous comprenons par jugement le résultat d’une enquête menée par la pensée. Ce type de pensée établit ce qui vaut la peine d’être préservé et, pour autant, développe une empathie, la capacité d’essayer de se mettre à la place de l’autre personne, de penser comme elle pense, de se sentir comme elle se sent, d’essayer d’être plus juste en pensée et en réaction.
Happinez : Cela ne signifie-t-il pas que, d’une certaine manière, nous voulons faire d’eux des adultes plus tôt que prévu ?
Jordi Nomen : Lorsque je parle de l’enfant philosophe, je fais ici référence à la possibilité que, grâce à ces qualités indispensables à la croissance, une nouvelle vision soit stimulée chez lui, une autre fenêtre s’ouvre pour contempler le monde : le regard philosophique. D’après moi, nous devons éclairer ce bâtiment appelé connaissance avec autant de fenêtres que l’on peut ouvrir. L’enfant arrive au monde avec une curiosité insatiable et une admiration immense et fascinée par ce qu’il découvre. Ce sont deux qualités philosophiques. Ce n’est pas pour rien que nous sommes l’une des espèces qui maintiennent la plus longue « juvénilisation ». Examinons d’autres espèces et constatons que les bases de la survie sont incorporées beaucoup plus rapidement que les nôtres. C’est l’instinct qui commande. Nous, les humains, nous devons apprendre la culture et nous trouvons, à la naissance, un monde déjà créé. Notre jeunesse doit être longue et pleine de nouvelles créations, de nouvelles réponses. C’est pour cette raison que nous intégrons d’abord la langue, puis l’écriture. Ce sont nos occasions de recréer le monde. Les enfants ont besoin de comprendre le monde, mais aussi de le changer. Il ne s’agit pas de les transformer en adultes à l’avance, mais de les faire grandir avec une perspective critique, créative et prudente.
Happinez : Qui était Matthew Lipman ?
Jordi Nomen : Matthew Lipman (1923-2010) était le philosophe et éducateur américain du programme Philosophy for Children. Ce projet vise à apporter de la philosophie aux enfants à travers une série de romans philosophiques, où garçons et filles de différents âges dialoguent autour de thèmes qui les surprennent dans leur vie quotidienne, à partir de leur propre admiration et de leur curiosité. C’est peut-être l’une des réussites les plus importantes du projet Lipman : placer les problèmes et les défis philosophiques dans le champ de la vie quotidienne des enfants et reconstruire l’approche adoptée par ces enfants pour y faire face.
Lipman, en réfléchissant sur ses expériences de professeur de philosophie auprès d’étudiants universitaires et dans le cadre des mouvements politiques survenus sur les campus universitaires américains dans les années 60 du siècle dernier, a conclu qu’il était nécessaire d’apprendre à penser de manière critique, poser des questions philosophiques et former des jugements raisonnables, et que tout cela devrait être réalisé à l’école. Sinon il était trop tard. Ses réflexions sur le besoin de faire de la philosophie avec des enfants l’ont amené, en 1969, à contacter la Fondation nationale des sciences humaines pour créer une lecture philosophique, sous forme d’un récit, destinée aux enfants de 11 ou 12 ans.
En 1971, pour évaluer la force du texte et les avantages que l’on pouvait tirer de la philosophie pour enfants, il demanda une bourse pour mener une étude d’un an avec des élèves de cinquième année du primaire (11 ou 12 ans) des écoles publiques de Montclair, New Jersey. L’évaluation des résultats a montré que les avantages de la philosophie se reflétaient dans tous les autres domaines de la connaissance.
En 1974, il créa, avec Ann Margaret Sharp, l’Institut pour l’avancement de la philosophie pour les enfants (IAPC). Le Montclair State College a proposé d’établir le siège de l’IAPC sur son campus. De 1974 à 1980, tous deux se sont consacrés à la rédaction de plusieurs récits correspondant à différents niveaux et domaines, ainsi que de manuels à l’intention des enseignants, afin d’expliquer comment le projet devait être mis en œuvre. Chaque niveau comportait un domaine de philosophie différent : nature, langage, logique, éthique… Pour l’évaluer, ils ont reçu une subvention de la Fondation Rockefeller, le service de test pédagogique, qui, avec Lipman en tant que chercheur principal, a engagé près de cinq mille étudiants sur une période d’un an.
Évidemment, il fallait aussi préparer les enseignants puisque mettre en œuvre le projet n’impliquait pas nécessairement une connaissance approfondie de la philosophie, mais plutôt une certaine manière de procéder et un profil de penseur philosophiquement actif. C’est pour cette raison que Lipman a commencé à proposer des séminaires d’une semaine dans des universités telles que Rutgers, Harvard, Yale, l’Illinois, Fordham et Michigan State. De plus, Lipman et Sharp ont écrit sur les fondements théoriques de la philosophie au niveau de l’école en publiant Grandir avec philosophie et Philosophie à l’école, en 1978. Philosophy for Children est devenu un mouvement dans tout le pays et des ateliers ont été organisés au sein de tous les États par l’intermédiaire du Réseau national de radiodiffusion du ministère de l’Éducation. Le mouvement s’est également répandu dans le monde entier, avec des organisations locales et nationales dans plus de quarante pays et des associations régionales en Europe, en Amérique latine et en Océanie. Lipman a fondé le magazine Thinking, le Journal de philosophie pour enfants (1979), dont il était le directeur au tout début et faisait ensuite partie de son comité de rédaction. En Catalogne, sa tâche s’est poursuit avec les efforts du groupe Iref (Institut de recherche pour l’enseignement de la philosophie). Matthew Lipman est donc le créateur du projet Philosophie 3/18.
Happinez : Quelle est l’importance des contes de fées dans l’enseignement de la philosophie aux enfants ?
Jordi Nomen : En racontant des histoires, nous dressons pour l’enfant un pont entre la réalité et le rêve, un chemin vers la fantaisie qui enrichira son processus de maturation et débutera par l’apprentissage d’un code moral et de vertus pouvant servir de point de départ à un adulte attentif aux soucis et questions. Si, en outre, nous ajoutons une réflexion profonde à ce qui a été lu, cela peut être une source de connaissances symboliques, sociales, historiques, géographiques et, pourquoi pas, philosophiques. En effet, de nombreux philosophes ont utilisé les histoires pour générer un apprentissage en profondeur, comme je l’évoque dans la deuxième partie du livre. Si cet adulte renforce, en outre, de manière consistante et cohérente l’apprentissage avec l’action de sa propre vie, l’enfant disposera d’un modèle précieux pour commencer à penser par lui-même.
La clé réside probablement dans la manière dont l’histoire est expliquée ou comment elle est lue. Faire des gestes, utiliser le regard, intégrer les images, lire à voix haute – à la place de l’enfant au départ, puis conjointement quand il sait déjà lire – semblent constituer une étape facilitante pour développer ensuite le dialogue philosophique. Puis poser des questions à l’enfant : que va-t-il se passer selon toi ? Comment le conte va-t-il se terminer ? Que ferais-tu si tu étais le héros ? Aimerais-tu vivre dans cette histoire ? Il était une fois, dans un pays très lointain, un enfant qui lisait et qui pensait, qui pensait et lisait. J’espère que cela ne demeurera pas juste une histoire et deviendra réel.
Happinez : Le bonheur est-il le but principal de la philosophie?
Jordi Nomen : À mon avis, il faut éviter de tomber dans le piège du bonheur. De nombreux essais et livres de développement personnel qui essaient de donner des recettes pour une vie heureuse ont été publiés ces derniers temps. La philosophie, savoir inquiet, questionne et critique mais ne garantit pas le bonheur. Ce n’est pas une clé qui vous permet d’ouvrir l’appartement et de l’habiter. C’est plutôt une école de lucidité, de critique et d’ironie. Le bonheur est toujours un idéal vide, que chacun peut remplir avec son propre sens. Il y a ceux qui vont parler de bien-être, de possession, de santé, de sérénité, de plaisir. Autant de définitions que de personnes. Attention, car la vie n’est pas simple et n’admet pas de réponses simples à des problèmes complexes. La vie est un essai et une erreur ; la vie est incompréhensible, imprévisible et pleine de hasards, avec des moments difficiles et des moments agréables. Que nos enfants apprennent à découvrir leur côté philosophique ne signifie pas les libérer de tout mal.
On nous vend le rêve confortable du bonheur, source de plénitude, construit comme un pays habitable dans lequel nous arriverons un jour où nous pourront réclamer passeport et droits de citoyenneté afin de ne plus jamais le quitter. Désolé, je ne suis pas d’accord. C’est juste un autre produit de consommation qui ne résiste pas à une analyse lucide. On ne peut pas choisir entre joie et tristesse, cette dernière ayant aussi une marge de manœuvre pour nous persécuter. Nous ne pouvons pas l’esquiver et nous avons alors deux options : regretter cette tristesse ou apprendre d’elle. Il est clair aussi que la joie apparaît de temps en temps avec, elle aussi, deux options à nous proposer : supposer qu’elle ne nous abandonnera pas et être frustré lorsqu’elle prend l’avion, ou bien la valoriser et en tomber amoureux de tout notre cœur, tout en la sachant inconstante. Le hasard existe et il se montre. Nous décidons si nous ne voulons pas le voir ou bien y faire face, chargés de souvenirs !
Par conséquent, les enfants doivent apprendre à philosopher, à ne pas vivre les yeux fermés et à ne pas croire en de fausses promesses. C’est vrai qu’il est plus facile de s’adapter à la réalité si on la regarde comme une sorte de loi insoluble. Le prémisse de cette loi serait “Les choses sont comme elles sont” et “Tais-toi et obéis” en serait la conclusion. Je pense que le bien-être et le bonheur que l’on nous promet nous engagent à fermer les yeux. Cette promesse comprend l’absence de douleur, d’effort, de passion et de rêve. Si nous demeurons dans une atmosphère sans critique, nous aurons un format confortable de nouveautés continues qui feront progresser nos désirs, les façonneront et les mèneront à une accumulation inconditionnelle. Ou non. Les conditions sont implicites dans ce piège du bonheur. Ne pas voir, ne pas écouter, se sentir mesuré, profiter de tout et ne rien interroger. La critique et la vérité peuvent mettre en danger ce bonheur. Et qui abandonnerait le bonheur, quel qu’en soit le prix ? La banalité doit remplacer l’essence, complexe et angoissante. Les trophées de la sexualité remplacent l’amour qui, de temps en temps, fait souffrir. Les liens virtuels remplacent les relations réelles, car le bonheur est construit à partir des photographies souriantes qui dominent les réseaux sociaux. La peine n’existe pas. La solidarité non plus, si elle implique un engagement, une action et des forces pour bannir le confort inhérent à la promesse. La justice n’est rien de plus qu’un slogan vide de combat, car elle perturbe la sérénité dont nous avons besoin. C’est la tyrannie déguisée en beauté. Bien sûr, beauté jeune et immaculée, car le déclin n’a jamais été ravissant. Vivre les yeux fermés, c’est l’enseignement à donner pour ne pas sortir de la « normalité ». Je suppose que vous lisez l’ironie. Et c’est pourquoi on a également apprivoisé la philosophie, cette mouche insidieuse qui remet en cause l’assurance de donner plus de force à ce que l’on croit. Le bonheur le prétend ! Mais n’est-ce pas simplement une forme d’aliénation ? Une forme effrayante de pauvreté, un déguisement?
Non, je ne promets pas dans ce livre le bonheur aux enfants. Apprenons-leur à se battre pour la vérité, la critique, la créativité, une citoyenneté engagée. La liberté, en bref. La philosophie défie les assurances avec des questions, questionne la pensée et l’autorité établies, dérange positivement, complique l’existence et la rend plus intense.
Happinez : Concrètement, que propose votre livre aux parents et aux enseignants ?
Jordi Nomen : Mon livre vise à offrir aux familles et aux enseignants un moyen pratique d’aborder la croissance et le développement d’une bonne pensée chez les enfants. En utilisant comme leviers des histoires, des jeux et de l’art, les méthodes habituelles de découverte de la vie ont pour but de les éduquer de manière critique, créative et éthique afin de mieux penser, de mieux agir, dans un monde qui aura besoin, à chaque fois plus, de citoyens capables de décider sans laisser personne derrière. La seconde partie de l’ouvrage contient des questions essentielles sur l’histoire de la philosophie occidentale et sur les ressources, dialogues, propositions et activités, de sorte qu’elles soient mises en pratique, même sans posséder de grandes connaissances théoriques de la philosophie. Il suffit simplement aux adultes de penser que les garçons et les filles peuvent, si nous leur donnons le temps et l’espace, améliorer leur pensée pour améliorer leur action.
Propos recueillis par Aubry François
© Charlein Gracia/Unsplash