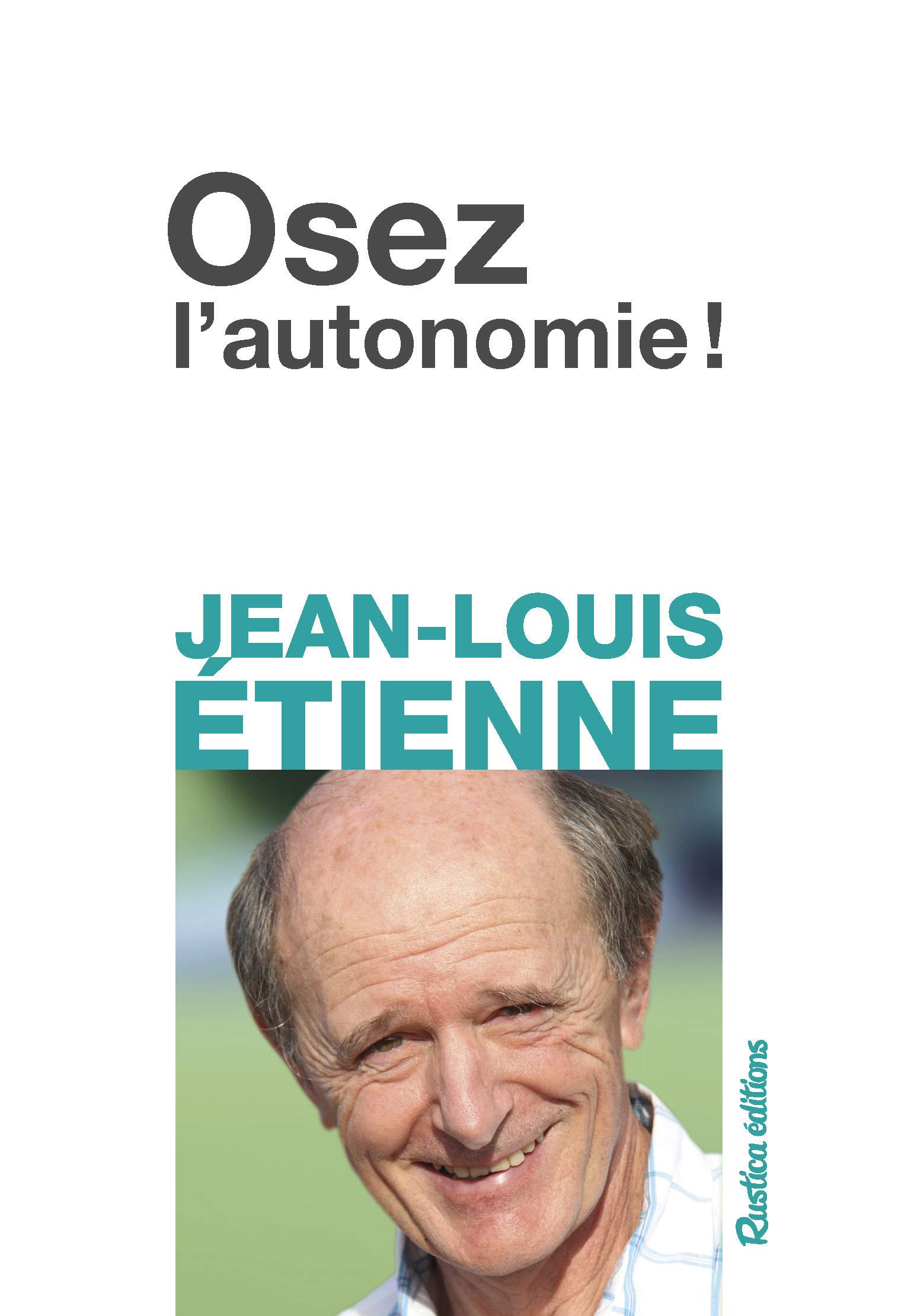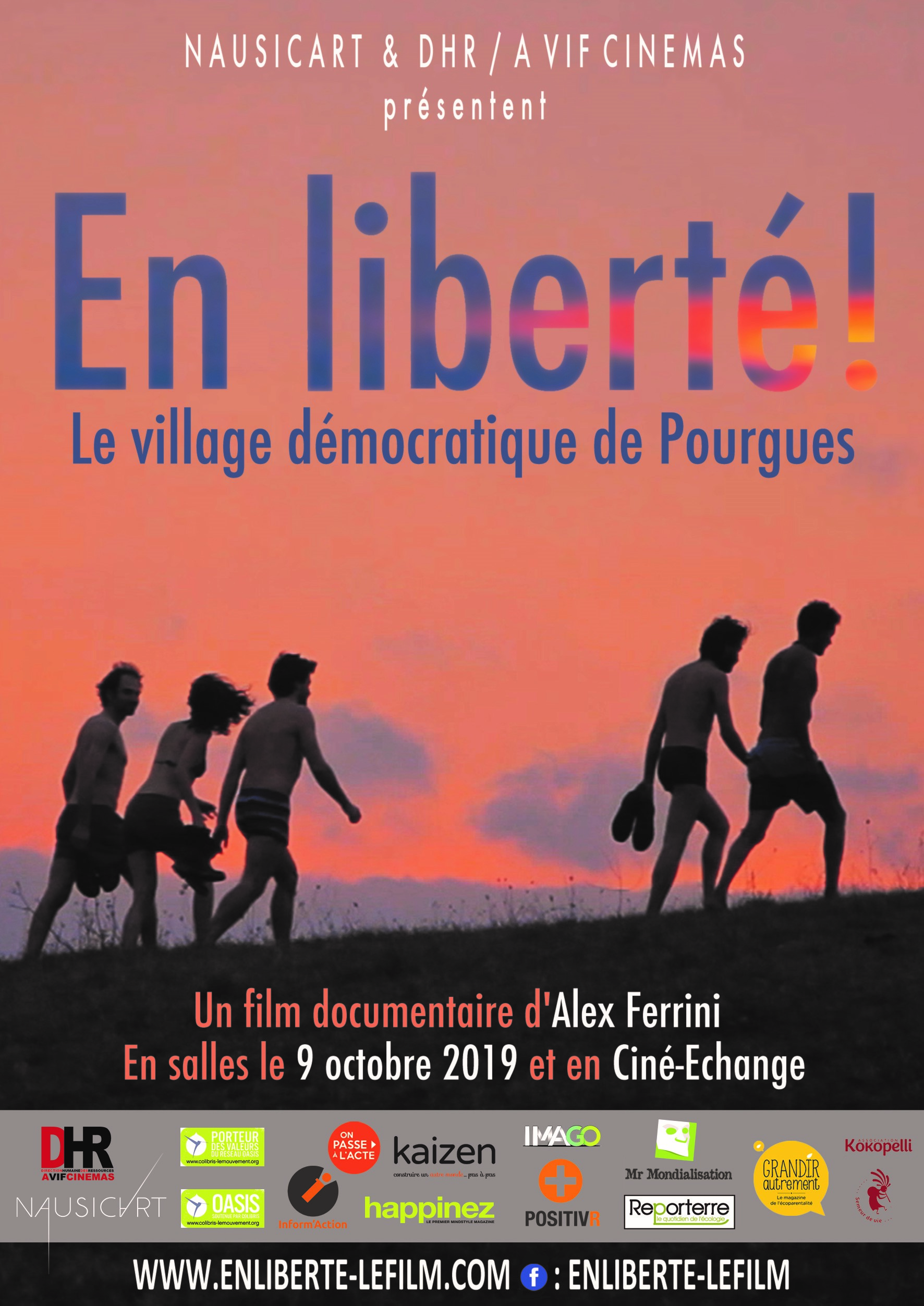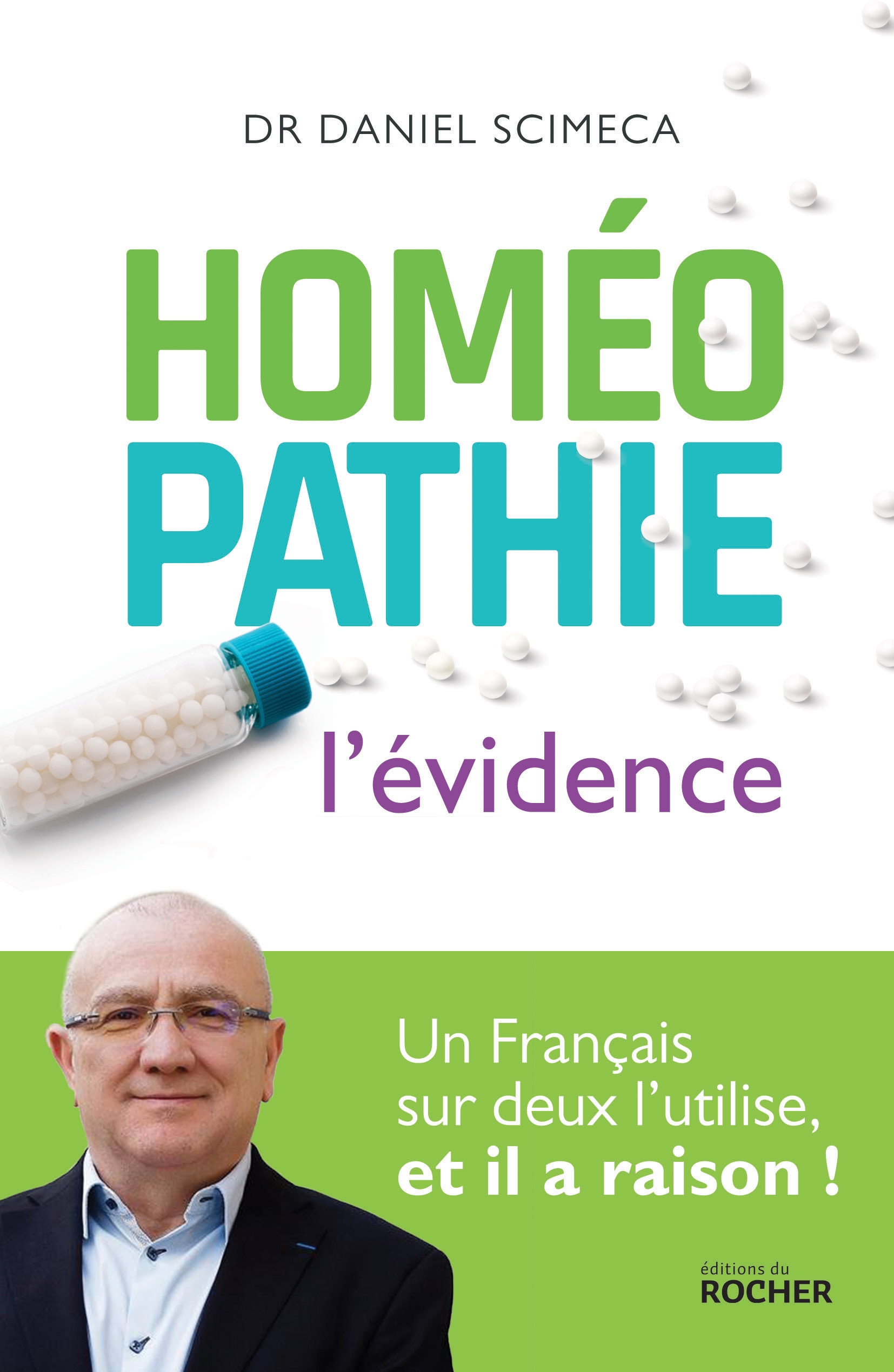Happinez : Pouvez-vous nous parler un peu du rat-taupe nu et nous dire en quoi cet animal a retenu votre attention de scientifique ?
Frédéric Saldmann : Le rat-taupe nu est une petite souris que l’on trouve en Afrique de l’Est, en Somalie et en Éthiopie. Alors qu’une souris vit au maximum trois ans, l’existence de celle-ci dure entre trente et trente-deux ans. Mais toutes deux possèdent un code génétique très proche du nôtre, au point que l’on ait fait des essais de médicaments sur la souris avant de les tester chez l’Homme. Trente ans pour un rat-taupe nu, c’est exactement comme si nous, humains, vivions six cent ans en bonne santé. Jamais de cancers : les tumeurs cancéreuses qu’on lui implante sont rejetées tout de suite et, fortement exposé à des cancérigènes chimiques, l’animal n’en développe pas davantage. Jamais non plus de maladies neurodégénératives comme Alzheimer ou Parkinson. Les rats-taupes nus sont comme neufs jusqu’au bout et leur fertilité demeure également intacte, mâles et femelles. Non seulement ils n’ont pas de maladies, mais en plus ils ne vieillissent pas. Imaginez-vous traverser des siècles en restant à l’âge de 18 ans. Et à l’autopsie, aucun organe n’est abîmé. Il est donc extraordinaire d’essayer de comprendre pourquoi. J’ai installé, à l’École Vétérinaire de Maisons-Alfort, la première animalerie en ramenant d’Afrique des rats-taupes nus. Et la Fondation de Recherches en Physiologie, dont je suis le directeur scientifique, l’étudie aussi.
À partir de votre observation de cet animal, pourriez-vous nous transmettre deux ou trois règles essentielles pouvant favoriser notre longévité ?
Premier point, déjà, le rat-taupe nu ne tient pas en place. On l’a mis dans des cages en plexi reliées à d’autres cages par des grands tuyaux en plastique, et il fait de la gym en permanence. On sait que chez l’humain, trente minutes d’exercice physique par jour sans s’arrêter diminuent de 40 % cancers, Alzheimer et maladies cardio-vasculaires. Les vingt premières minutes ne servent pas à grand-chose, on brûle du sucre, mais au-delà, on commence à brûler des mauvaises graisses, et une étude a montré qu’on libérait des molécules protectrices. Cependant, ces molécules n’ont qu’une durée de vie de 24 h. Ce qui veut dire que si l’on veut réellement se protéger du vieillissement, le premier réflexe, c’est de faire de l’exercice physique tous les jours. Cela marche comme une pilule de jouvence quotidienne ; il y a des gens qui me disent qu’ils font du sport le week-end, je leur réponds que c’est comme se brosser les dents uniquement en fin de semaine ! Cela peut être de la marche, du vélo, de la natation… L’essentiel est que l’exercice physique soit continu. Toutes les personnes passent au moins une demi-heure tous les jours à lire leurs mails, à envoyer des SMS ou à regarder la télévision. Eh bien moi, je peux vous dire que je fais quotidiennement une heure de vélo d’appartement en faisant mon courrier. C’est vital.
Le deuxième exemple, très intéressant, est que le rat-taupe nu a une température de 32°C. Si l’on fait baisser la température d’un demi-degré, la durée de vie des souris augmente de 15 à 20 %. Et une étude a montré que les centenaires ont en commun une température plus basse. Comment baisser notre température corporelle pour faire de vieux os en bonne santé ? Pour cela, il n’y a pas de médicament et si l’on se met au froid, notre thermostat interne fait aussi que l’on se réchauffe tout de suite. Donc cela ne fonctionne pas. Par contre, il y a une première clé. Quand on mange beaucoup et qu’on est en surpoids, on a chaud après un repas. À l’inverse, les gens qui pratiquent un jeûne séquentiel ont un peu froid. La température baisse et l’inflammation aussi. Si l’on propose aux rats-taupes nus une alimentation abondante, ils prennent juste ce qu’il faut. Pour ma part, je pratique le jeûne séquentiel : pendant quatorze heures tous les jours, je bois du thé vert, de l’eau, du café sans sucre et sans édulcorant… Et je fais deux repas au lieu de trois. On produit 20 millions de cellules à chaque seconde pour remplacer celles qui sont usées ou mortes. Et le risque d’erreur de copie augmente avec l’âge. Quand on jeûne, on renforce son ADN : moins d’erreurs de copie, moins de cancers. On a le teint plus clair, plus tonique, moins d’allergies, moins d’asthmes, moins de rhumatismes. En fait, on lutte à ce moment-là contre notre obsolescence programmée, on laisse au corps le temps de se régénérer, de se réparer. Il est d’ailleurs très intéressant de constater que toutes les religions du monde, depuis le début de l’humanité, parlent du jeûne, c’est un message qui vient de la nuit des temps. On réactive un marqueur biologique ancien. Donc, si l’on veut tenter ce jeûne séquentiel, sauf si l’on a un problème d’hypoglycémie et que le médecin le contre-indique, cela vaut le coup d’essayer. On va gagner en énergie. Digérer, ce n’est pas rien. Cela met en route plusieurs dizaines d’organes dont le foie, les reins, des hormones, des enzymes, c’est tout un bazar !
Aujourd’hui, on ne meurt pas de carences, on meurt d’excès. Dès que l’on a faim, c’est une calamité : vite, il faut que l’on mange ! Nous vivons dans un monde où tout symptôme appelle son médicament. J’ai une douleur : un antalgique ; je n’arrive pas à dormir : un somnifère ; je suis triste : un antidépresseur ; j’ai un problème d’érection : un comprimé ; et ainsi de suite. La faim est déclenchée par une hormone que l’on nomme la ghréline, l’hormone de l’appétit. Et l’on vient de découvrir que cette hormone a d’autres actions : elle stimule l’autophagie. L’autophagie est une sorte de cure de détox expresse, de purification intérieure où l’on élimine nos cellules malformées, malades ou mortes. Un chercheur japonais a d’ailleurs été récompensé par un prix Nobel pour ses recherches sur le sujet. Par ailleurs, la fameuse ghréline stimule l’hormone de croissance qui est aussi anti-vieillissement. Autrement dit, lorsqu’on a faim, il faut, pour se faire du bien, vivre un peu avec cette faim et se mettre à table uniquement si notre corps le demande vraiment. Écouter avec bon sens ses signaux. Quand il ne nous en envoie pas, c’est qu’on n’en a pas besoin. Par contre, il est nécessaire de boire beaucoup d’eau, de toujours bien s’hydrater au cours de la journée.
Troisième exemple : j’ai publié un article sur PubMed, paru aux USA il y a très peu de temps, au sujet de l’oxydation. On a observé que, quand le rat-taupe nu naît, il est complètement oxydé. Un taux d’oxydation et de carbonisation record. On se dit « mais il va mourir ! » Et pourtant, il demeure en parfaite santé pendant 30 ans. Cela questionne donc les antioxydants.
Le quatrième et dernier point, qui est essentiel, est que les gens vivent plus longtemps lorsqu’ils donnent du sens à leur vie, qu’ils sont en activité. Et on s’est aussi aperçu que seules les “vraies” activités nous apportaient quelque chose. Exemple typique, on s’est récemment mis à étudier des dossiers concernant l’Alzheimer chez l’Homme et le point commun, c’est la retraite précoce. Même la retraite de celui qui dit « Oh là là, depuis que je suis en retraite, je suis débordé entre le golf, le bridge, l’association des petits chevaux, le conseil, les petits-enfants, c’est pire qu’avant, je n’ai plus une minute à moi ». La biologie ne ment pas. Quand un homme prend sa retraite à 55, 60, 65 ans, les risques d’Alzheimer augmentent de 15% tous les 5 ans.
En résumé, pour vivre plus vieux : faire de l’exercice physique – parce qu’un à deux pour cent de perte de muscle par an ce n’est pas rien ; s’intéresser à sa nutrition car 30 % de calories en moins, c’est 20 % d’espérance de vie en plus ; prendre deux repas au lieu de trois et bien s’hydrater. Le point bonus est l’activité sexuelle : on a découvert que 12 rapports par mois augmentaient de 10 ans l’espérance de vie en bonne santé.
Pensez-vous que notre esprit puisse avoir un rôle dans le processus de guérison ?
Il existe une force mentale qui soigne et, au plus profond de l’être, des moyens d’autoguérison extrêmement puissants qui peuvent prévenir les maladies. Par exemple, on a fait une étude sur les gens soulagés par l’effet placebo. On leur a donné un comprimé parce qu’ils avaient mal au dos et 40% d’entre eux se sont sentis soulagés alors qu’ils n’avaient pris que du sucre, sans le savoir. On s’est dit « c’est dans la tête », mais des prises de sang réalisées après-coup ont révélé que ces personnes sécrétaient des taux très élevées d’une molécule comparable à la morphine. Chacun fabrique donc ses propres médicaments. À l’inverse, nous pouvons aussi nous dévorer de l’intérieur en secrétant d’énormes quantités de cortisone. Ce qui peut aider, c’est la méditation, les massages, la joie de vivre, les amis. Tout cela est positif. En même temps, il faut faire très attention à soi. Nous sommes des montres automatiques qui se rechargent dans le mouvement, le mouvement intellectuel et physique. Einstein l’a dit : « La vie, c’est comme la bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre ». Quand on a les deux jambes dans le plâtre pendant deux mois, au moment de le retirer, on tombe, parce qu’il n’y a plus de muscles. Eh bien, pour le cerveau, c’est la même chose.
Propos recueillis par Jean Staune et Aubry François
© Anton Malanin/Unsplash