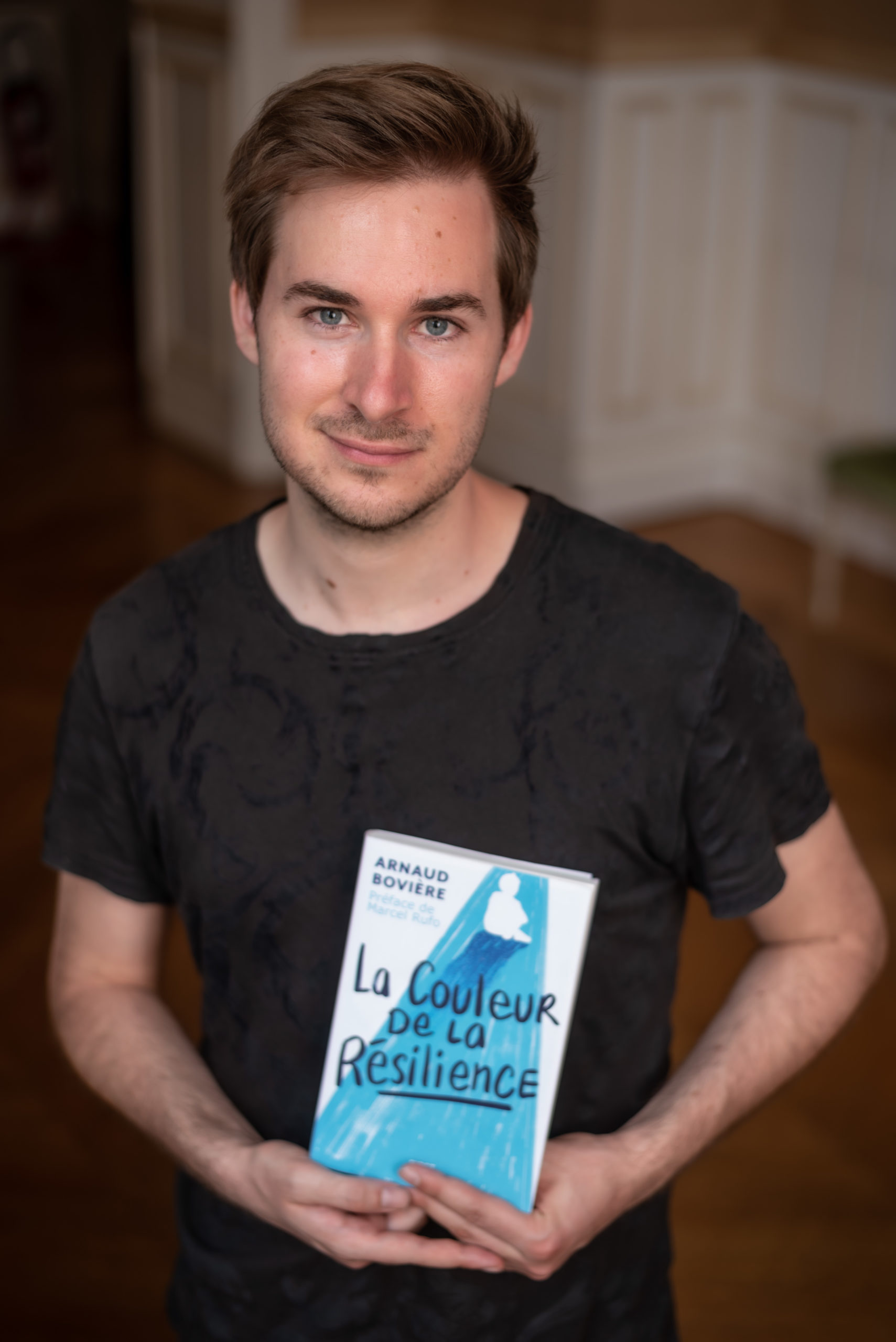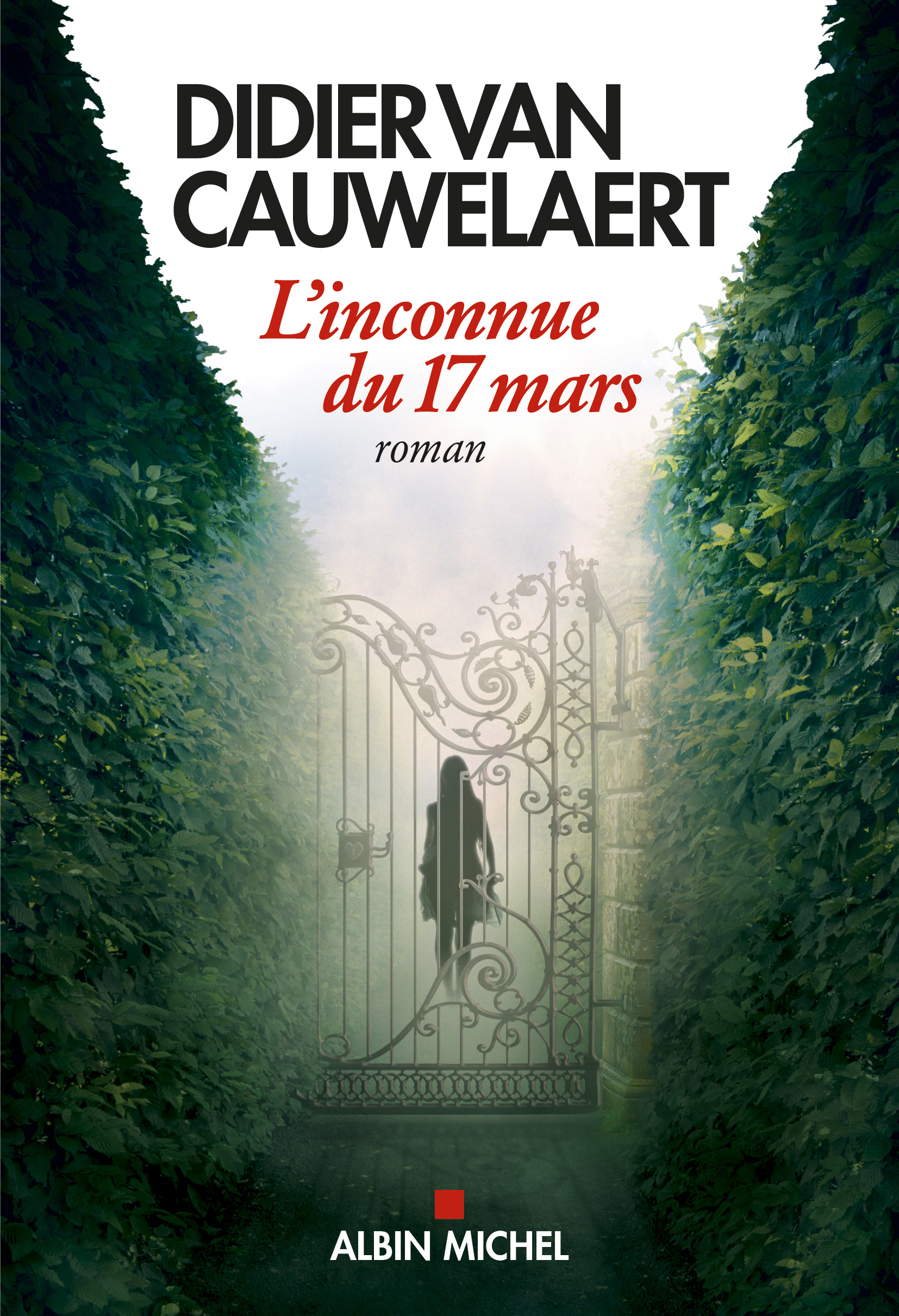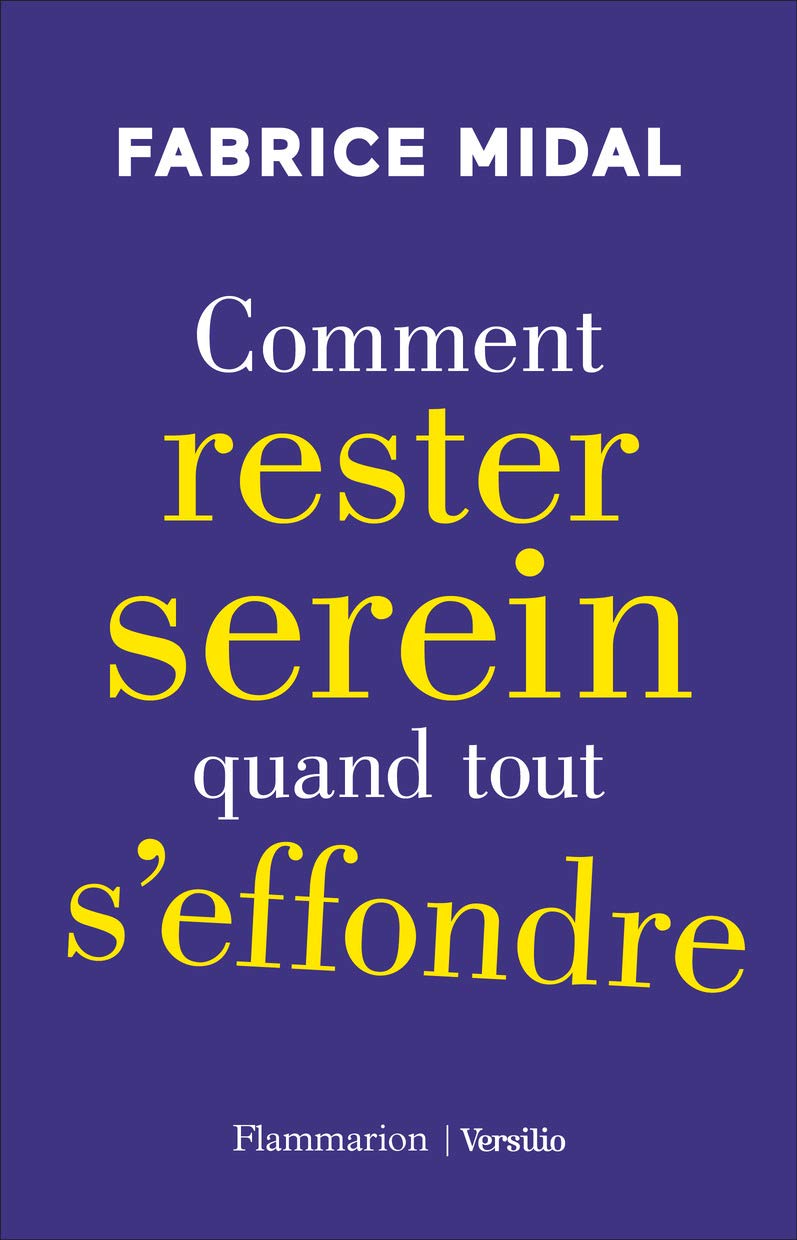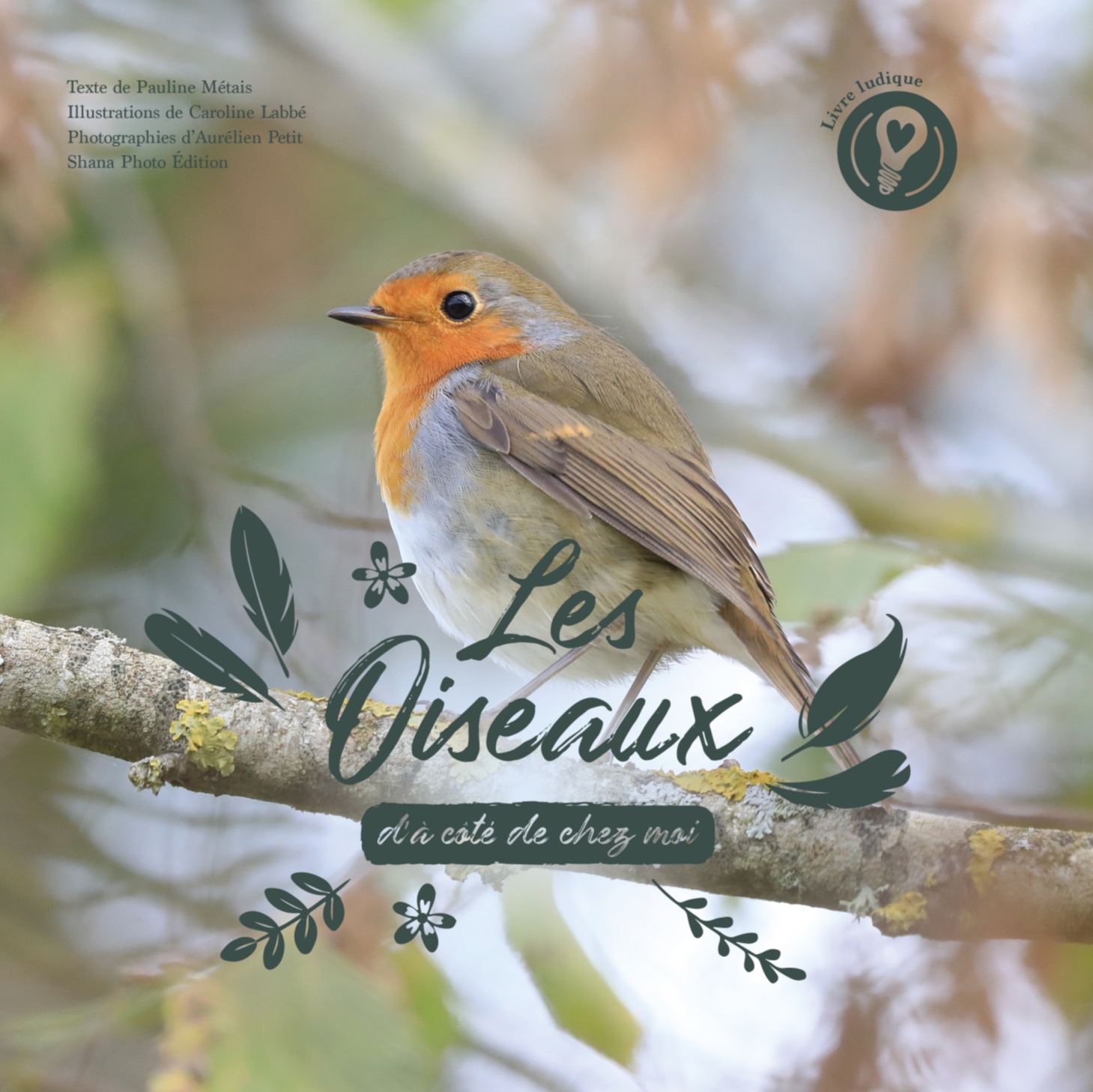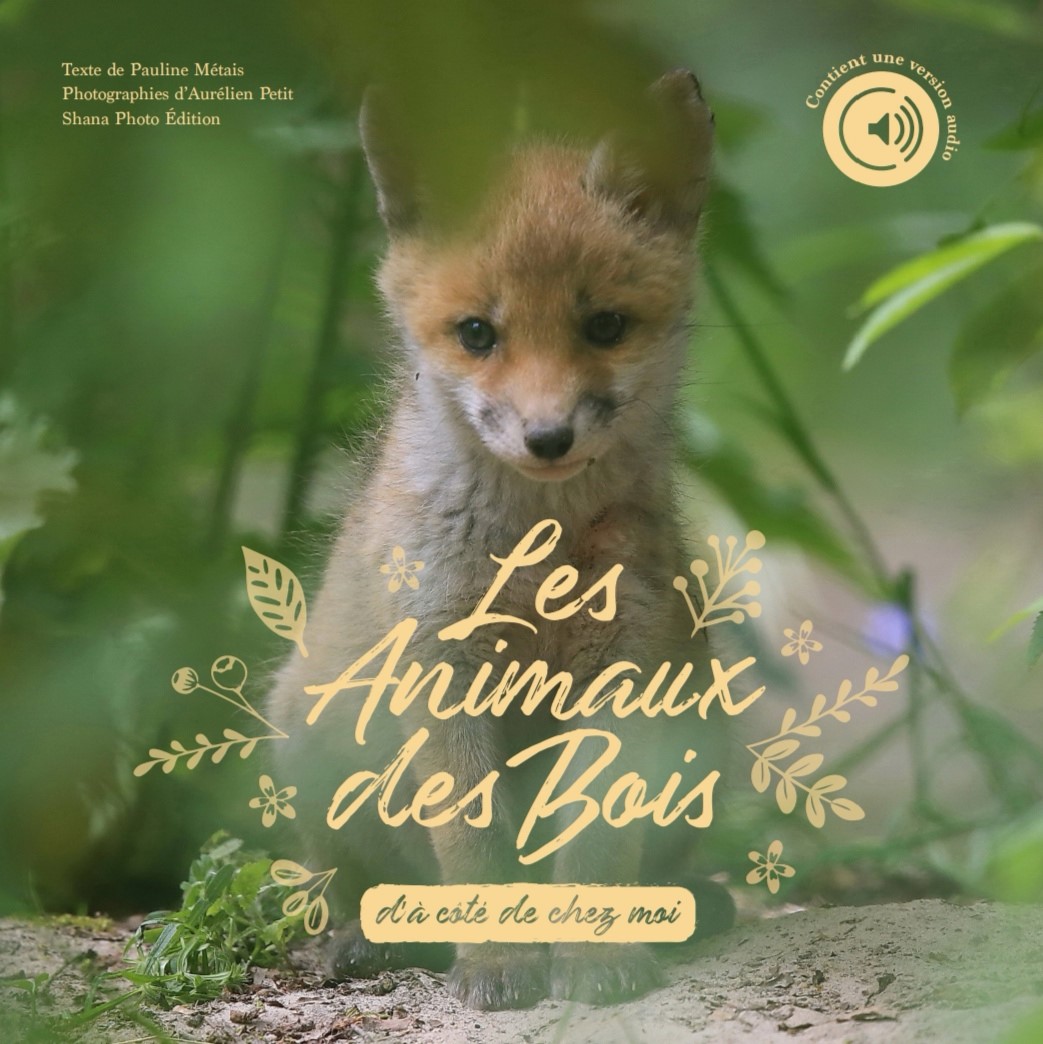Happinez : Comment se traduit au quotidien le fait d’être un(e) Haut Potentiel ?
Catherine Besnard-Peron : Retranscrire la réalité intérieure d’un Haut Potentiel est à ce jour une forme de défi car cette appellation regroupe des profils bien différents. Je peine parfois à m’y retrouver pour échanger avec mes pairs sur une base commune, alors que je travaille sur, et avec ce sujet, depuis 2005. Le “i” de Haut Potentiel Intellectuel ayant disparu au fil des années, il ne reste qu’une étiquette, “Haut Potentiel” reposant sur des paramètres eux-mêmes très différents en fonction des interlocuteurs.
Par exemple, être Haut Potentiel à Haute Sensibilité ne revêt pas les mêmes caractéristiques qu’un(e) Haut Potentiel à Haut Quotient Intellectuel.
Le premier concerne 20 à 30% de la population générale (selon la recherche mondiale sur ce sujet, à partir des travaux d’Elaine Aron, modèle SPS, Sensory Processing Sentivity) tandis que le second concerne une petite frange de la population, définie sur un critère simple, mais qui suppose d’avoir passé un test de QI , mesuré à 130 minimum, ce qui positionne la personne dans le percentile 98, soit 2% de la population générale.
Encore plus rare, le Haut Potentiel à Haute Sensibilité et à Haut Quotient Intellectuel…
La personne à Haut Potentiel à Haute Sensibilité se remarquera à sa propension à être stimulée par des informations sensorielles fines, ou à faible signal, par une intensité émotionnelle forte ou une capacité innée à se mettre à la place d’autrui. De ce fait, elle pourra et ce, plus rapidement qu’une personne normalement sensible, se sentir submergée et saturée par toutes ces stimulations. La jolie contrepartie étant que, même envahie par les informations, une pertinence surgira, après un temps plus ou moins long, sous une forme de fulgurante que l’on nommera parfois “intuition”… Ainsi elle pourra se sentir lente et rapide à la fois…
A contrario, le Haut Potentiel à Haut Quotient Intellectuel se caractérisera par des habiletés intellectuelles objectivement plus rapides et plus puissantes que la moyenne. Avec un niveau d’abstraction qui peut à la fois le faire sentir en décalage, non pas de pensée, mais de niveau logique, celui auquel il résout les problèmes ou les questions qui se posent à lui.
Et enfin une personne à Haut Potentiel s’exprimant, et par une Haute Sensibilité et un Haut Quotient Intellectuel, s’appuiera sur les atouts de chacun des deux profils et leurs contreparties aussi.
Quelle est la problématique qui se joue autour de l’étiquette de Haut Potentiel ?
Revendiquer les attributs d’un Haut Quotient Intellectuel sans avoir passé de test de QI n’a pas vraiment de sens, hormis si l’on est attaché à l’étiquette. De même, pour la Haute Sensibilité, sans en avoir exploré les différentes facettes.
La confusion croissante depuis une douzaine d’années sur le sujet du Haut Potentiel a renforcé le pouvoir de l’étiquette sur les personnes qui se sentent atypiques ou différentes, comme si dehors de cette étiquette, il n’y avait point de salut pour elles….
Initialement pourvoyeuse d’un certain réconfort, elle se révèle aussi parfois comme un piège retors. Si mon étiquette, celle du Haut Potentiel, quel qu’il soit, devient pour moi si importante que j’ai besoin de l’utiliser, à plus long terme, pour m‘affirmer et revendiquer ma place dans la vie, alors j’en devient prisonnier, puisqu’en réalité j’ai toujours le droit d’avoir une place, et cela uniquement par le fait d’être un être vivant.
Quels seraient vos conseils pour s’en libérer ?
Friedrich Nietzsche nous interpelle sur la liberté existentielle : « Quel est le sceau de la liberté acquise ? Ne plus avoir honte de soi-même »
Trouver la “bonne” étiquette est de première importance, afin de se libérer d’une remise en cause identitaire parfois permanente, de s’extraire de questionnements sur sa propre normalité, qu’elle soit relative à la sensibilité ou bien au QI.
Explorer et s’adonner à vivre les attributs de l’étiquette. Puis cesser de lutter pour y correspondre totalement, au risque de la perdre, afin qu’elle ne reste pas une nouvelle norme à satisfaire.
Ne plus avoir honte de soi-même, pour assumer pleinement sa condition humaine, libre et imparfaite.
Trouver la bonne étiquette, afin de mieux en sortir… est un chemin parmi d’autres pour sortir d’une potentielle errance thérapeutique qui, telle un ressac, ramène inlassablement la personne à se questionner sur son identité (Qui suis-je ? ) alors que la véritable question existentielle est : Comment veux-je vivre ma vie ? Qu’est-ce qui me met en joie ? Quel élan traverse mon corps et le met en mouvement ? Avec qui ai-je envie d’être en relation ? Quelles sont les valeurs qui soutiennent ma relation au monde ? Comment ai-je envie de vivre dès aujourd’hui si jamais je devais mourir demain ?
Pour s’inscrire au Congrès virtuel de la Douance : ici
Propos recueillis par Aubry François
Visuel © Jakob Owens / Unsplash