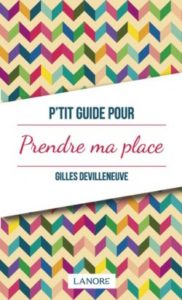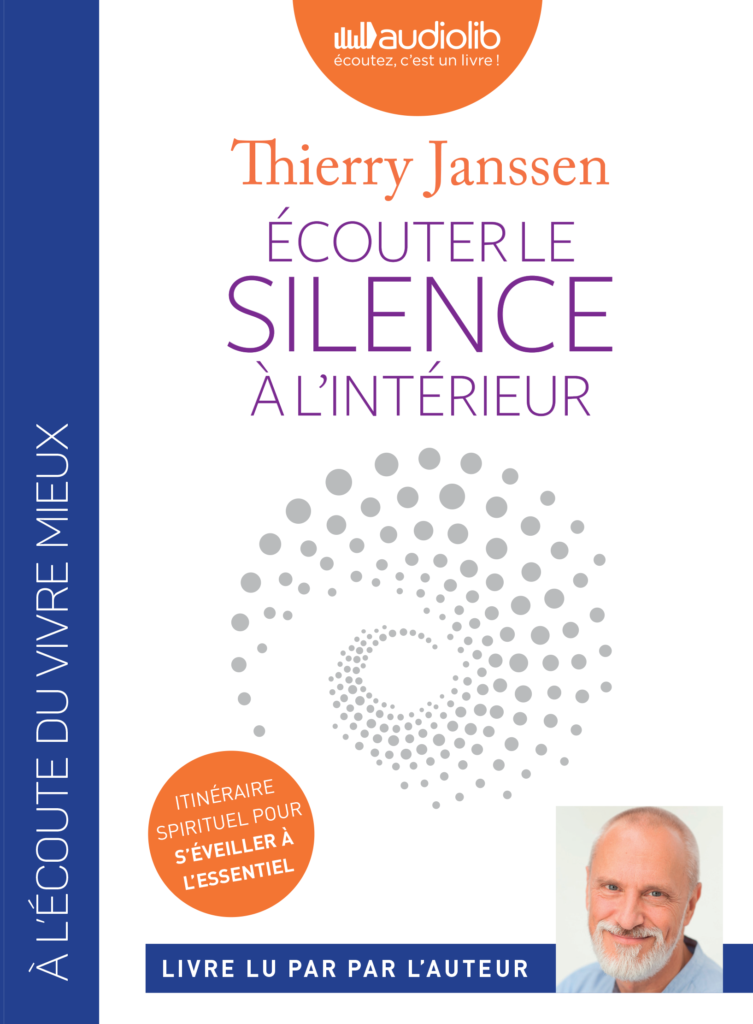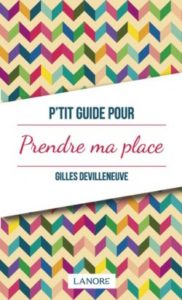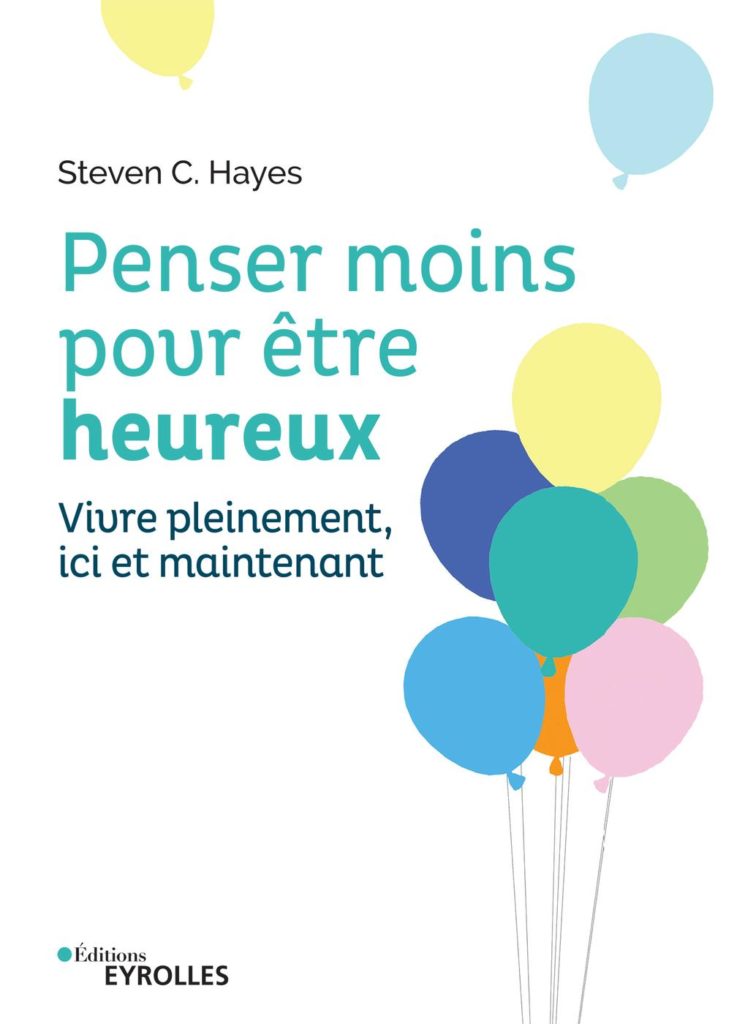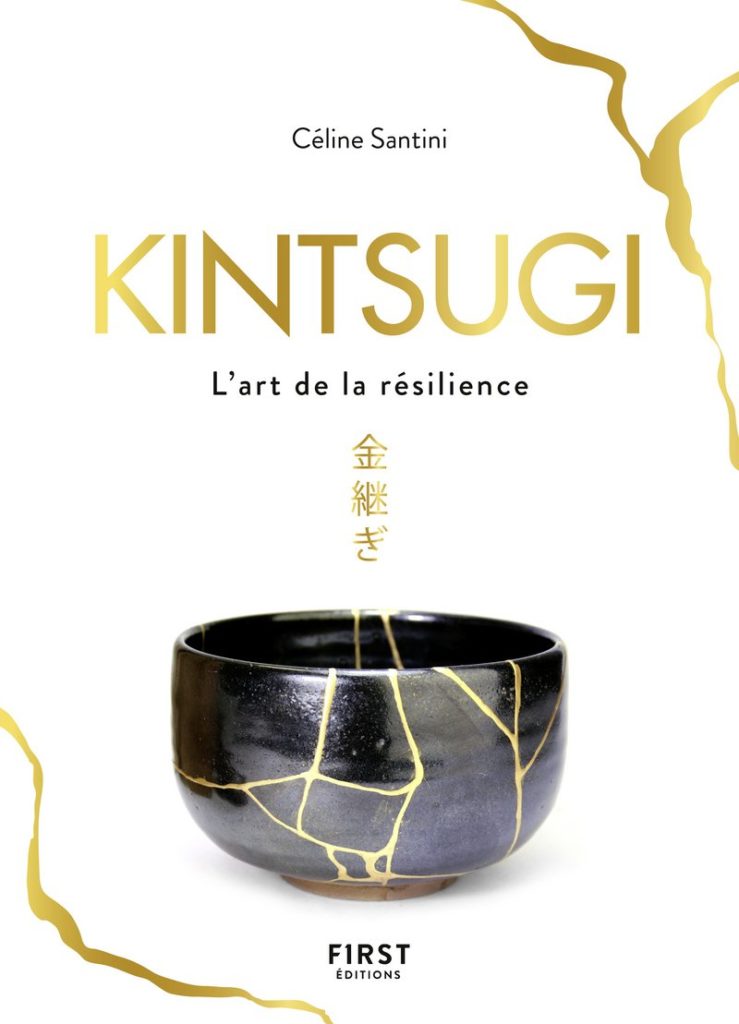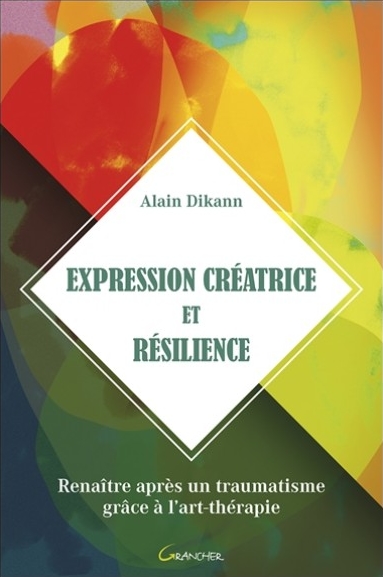Happinez : L’expression “prendre sa place” n’implique-t-elle pas nécessairement un rapport conflictuel aux autres et au monde ?
Gilles Devilleneuve : Tout d’abord, il convient de noter le titre de ce P’tit Guide : son intitulé est le suivant … pour prendre MA place et non pas « … pour prendre SA place ». Ce qui montre bien qu’il s’agit avant tout d’un travail personnel intérieur dans un premier temps, et non pas d’une conquête à l’encontre des autres et du monde. C’est pour cela que je préfère parler d’épanouissement personnel plutôt que de développement personnel.
Nous sommes manipulés par des grands mythes qui nous font croire que nous avons le pouvoir de rendre les autres heureux ou malheureux, et qu’ils ont la même capacité de faire notre bonheur ou notre malheur. Ces mythes (et notre insatisfaction) sont nourris par nos différents besoins tels que le besoin de reconnaissance, le besoin d’amour, de compter pour quelqu’un, d’avoir de la valeur à nos yeux, le besoin de se situer par rapport aux autres et de rechercher la sécurité, de réagir par rapport au monde, etc. De ce fait, nous adoptons des positionnements orientés par la comparaison, l’acceptation ou le refus de soi et de l’autre. Ces positionnements sont tournés vers l’extérieur.
Prendre ma place permet d’adopter un (nouveau) positionnement centré sur moi-même, ce qui n’a rien à voir avec l’égocentrisme ou le nombrilisme, mais permet de me (re)connaître moi, d’identifier mes besoins, mes aspirations, mes potentiels et mes difficultés. Tout ce qui constitue mes fondations, avec des limites qui vont permettre une identification de territoire : ici, c’est chez moi, rien qu’à moi, et là c’est le point de rencontre avec les autres. Chaque zone est bien identifiée, différenciée.
Lorsque je me positionne clairement, cela pousse instinctivement mon interlocuteur à faire de même. Chacun reste libre de se positionner ou non.
Quand je suis centré, quand je prends ma place, je vais chercher en moi ce que j’ai à offrir au monde, de manière cohérente, dans le respect de moi-même et de mon environnement. Bien sûr, cela passera par des désaccords, ces fameux conflits qui font si peur car trop souvent nous les assimilons à la violence et au combat. Bien sûr, il va falloir apprendre à dire non, dans le bon temps, à la bonne personne. S’il y a des soucis, des problèmes, nous pouvons chercher des solutions ensemble, partager nos points de vue pour évoluer, chacun par rapport à lui-même, à ce qui est ”juste” pour lui. Je ne parle pas là de justice mais de justesse. Nous pouvons aller de l’avant l’un avec l’autre, chacun sur sa route, en individu responsable et libre. C’est aussi cela, prendre ma place.
Je vais devoir accepter le fait que je ne peux pas transformer l’autre, mais que je peux transformer ma façon d’être avec lui. Ce n’est pas en m’opposant à lui que je vais exister. Notre désaccord éventuel n’est pas désamour mais clarification de positions, ce qui permet de se manifester mutuellement du respect, et d’éviter ainsi des conflits stériles en vivant en bonne intelligence. Nous sommes tous différents, chacun unique et original, c’est donc tout à fait normal que nous pensions et agissions différemment. L’important c’est de toujours être clair, “juste” avec soi-même afin de pouvoir être pareillement clair et “juste” avec les autres.
Je prends ma place, je lui laisse la sienne.
La notion de place est ainsi : elle ne peut se définir par rapport à quelqu’un ou au monde extérieur. Cela ne correspond qu’à un rôle, pas à une place.
Ma place c’est simplement, mais totalement, être moi.
Happinez : Qu’est-ce qui peut nous avoir empêché, jusqu’ici, de prendre notre place ?
Gilles Devilleneuve : Nous subissons de nombreux conditionnements qui nous attribuent une place dans ce que j’appelle notre “position de base”. Les projections parentales, le couple que nos parents ont formé, son évolution, la construction d’une famille, l’éducation reçue, l’amour reçu ou non, la position dans la fratrie, les différents événements qui jalonnent notre vie (divorce, famille recomposée, deuil), l’activité professionnelle, tout cela nous positionne, mais pas forcément à notre juste place. Nous adoptons des comportements conformément aux idées et valeurs inculquées ou acquises.
D’autre part, nous n’avons pas appris à dire ou à entendre NON. Puisque souvent nous pensons être aimés pour ce que nous faisons plutôt que ce que nous sommes, nous avons appris à dire OUI même si nous pensons NON. Cela évite de faire des vagues, de provoquer conflits et disputes.
Nous avons aussi tendance lorsque nous entendons le besoin de l’autre à nous croire obligé de le satisfaire immédiatement, comme si nous étions responsables de ce besoin. La notion de devoir ou d’attention à l’autre peut constituer une véritable fuite de soi sous couvert d’un comportement familial ou social correct. Mais attention : si je prends soin de l’autre en me négligeant moi-même, j’entretiens la négligence et non pas le soin.
La pseudo maîtrise de soi est aussi un leurre dangereux : en se maitrisant soi-même, il serait possible de se libérer de ses émotions, de ses peurs, de ses phobies ou de ses inhibitions, mais le pouvoir sur soi conduit à une négation de soi. Je maitrise, je réfrène et finalement je me coupe de mes émotions donc de moi-même. Quand je veux maitriser, cela veut dire qu’une partie de moi ne me convient pas, que je ne l’aime pas et que je veux la remplacer par autre chose.
La connaissance de soi ne saurait supporter pareille amputation. L’affirmation de soi débute par l’accueil, la reconnaissance et l’amour de soi-même. Sur toutes les facettes de l’individu. Dans le respect de toutes ses composantes.
Happinez : Que conseilleriez-vous à tous ceux pour lesquels “prendre sa place” s’apparente à un insurmontable défi ?
Gilles Devilleneuve : Bien souvent, nous cherchons à l’extérieur ce que nous possédons à l’intérieur sans toutefois le connaître ou le reconnaitre, et c’est pour cela que cela ressemble à un véritable défi dans un monde inconnu et que nous ne maîtrisons pas.
Donc première chose, se centrer sur soi-même et oublier toute notion de perfection, d’idéalisation et de jugement.
Faire des inventaires : nommer clairement “ce qui va” et “ce qui ne va pas” en soi et reconnaitre les situations et les sentiments ou angoisses qu’elles génèrent. Sans juger ! Il faut juste nommer, inventorier.
Identifier et différencier mes sentiments et mes besoins de manière à poser des priorités en termes de besoins fondamentaux (besoin de reconnaissance, de sécurité, etc.) afin de m’engager dans ce sens sur mon chemin de vie.
Identifier mes qualités et mes potentiels afin de (re)connaitre les ressources dont je dispose pour me développer et me transformer. En même temps, cela va me rassurer sur le fait que je peux être heureux, que j’en ai le droit et les moyens.
Ces différents inventaires me concernent, donc ils ne me coupent pas de mon entourage et de mon environnement. En même temps, ils me donnent la responsabilité de tendre vers mes besoins prioritaires, sans me juger, sans crainte des autres. Cela se situe de moi à moi. Je m’écoute et je me respecte. Et je sais que je dois avancer avec tous ces éléments qui me constituent sur ma propre route, seul, indépendant, individualisé. Je m’en réjouis, et je me félicite à chacune de mes (petites) avancées. Je me fais confiance. Ce n’est pas le contrôle qui me permet de me sentir en sécurité, mais bien la confiance, la confiance en moi.
J’accepte de ne pas être tout-puissant et de rencontrer des obstacles et des difficultés. Parfois je vais tomber, me tromper, adopter des attitudes qui ne seront pas toujours “justes”. J’ai le droit de ne pas être au maximum de ma forme tous les jours, de me sentir faible et perdu par moments, de douter. L’humilité permet d’accueillir ces difficultés, d’accepter que tous mes efforts ne soient pas toujours récompensés (ou pas forcément à la hauteur de mes attentes). L’humilité me permet de consentir à changer ma façon d’être et d’agir sans attendre que les autres changent, de renoncer à mon désir de toute-puissance. De m’aimer et me comporter d’une manière “juste”.
Le changement fait peur. Même lorsque l’on ressent un besoin impérieux de changer. La peur entre en lutte avec la confiance. Si nous restons dans une vision binaire des choses, nous aurons tendance à relâcher l’effort : « j’ai peur donc je ne change pas, je ne vais pas y arriver ». Ou alors je nie mes peurs pour avancer à tout prix, sans tenir compte des capacités, des freins, des circonstances. Lorsque je fais mes inventaires, je comprends que je peux envisager des situations qui sont complémentaires : « j’ai peur ET je veux changer ».
Vouloir changer en se comparant revient à se renier soi-même. Je suis unique, différent, donc je n’ai pas à me comparer, il n’y a pas de moyen de comparaison. Rien ni personne n’est mieux ou moins bien. Tous sont différents.
Il va donc falloir que j’accueille ma différence. Une nouvelle fois, retour aux inventaires. Sans jugement, avec empathie. Je suis ainsi, je suis riche de ce que je suis, je le développe et l’offre au monde. Je reconnais donc ma / mes différence(s). Je les aime, les accepte car elles constituent une pièce de puzzle unique que j’apporte au grand dessein du monde. Sans moi le puzzle ne pourrait pas être complet. J’y apporte un sens particulier, une couleur, une vie. Ma vie revêt un caractère sacré. Mon être, mon individu, MOI, aussi. D’où le grand respect que je me dois, que je dois aussi aux autres dans leurs différences et qu’ils me doivent pour ma particularité. Et cela à tous les niveaux : mon corps, mon cœur et ma pensée.
Enfin, si le chemin parait trop difficile dans la solitude, se faire accompagner par un professionnel compétent.
Happinez : Finalement, comment savoir si l’on se trouve à sa plus juste place ?
Gilles Devilleneuve : Vous avez raison de dire “à sa plus juste place”, car LA juste place n’existe pas en tant que telle. L’évolution de l’être est permanente et oblige ainsi à des remises en question régulières. Ce qui est ma place aujourd’hui pourra ne plus l’être demain, en fonction de mon épanouissement quotidien.
Il est donc important de se poser régulièrement la question « Ce que ce que je fais, ou ne fais pas, est-ce juste pour moi ? » Encore une fois, “juste” se comprend non pas au niveau de la justice mais de la justesse. Suis-je bien en accord avec ce que je fais, ce que je dis, la façon dont je me comporte ? Si oui, je suis à ma plus juste place. Si je doute, ou si je réponds non à cette question, alors il va falloir m’adapter, travailler pour tendre et grandir vers ma nouvelle place.
Cela passe notamment par la remise en question de mes valeurs et de mes croyances. M’appartiennent-elles vraiment ou sont-elles issues de mon éducation ou de mon entourage ? Sont-elles actuelles dans ma vie d’aujourd’hui ou me faut-il les mettre à jour, en changer ? Mes croyances sont-elles des ressources ou des limites ?
Lorsque je me sens en accord avec moi-même, j’établis un meilleur rapport avec le monde et les autres. C’est là que je me sens à ma place : centré et en même temps ouvert, accueillant pour mon entourage et mon environnement. Prêt à donner le meilleur de moi-même et à recevoir en échange, sans jugement, sans comparaison ni jalousie, en partage et en paix.
Lorsque je suis à ma plus juste place, je sais, je sens que je suis capable de m’assumer moi-même, je suis conscient de tous mes potentiels, de mes ressources, je vis pleinement mon indépendance et ma relation au monde sans dichotomie, je suis heureux d’être moi.
Propos recueillis par Aubry François
Portrait © Cécile Gorce – PhotoExpress