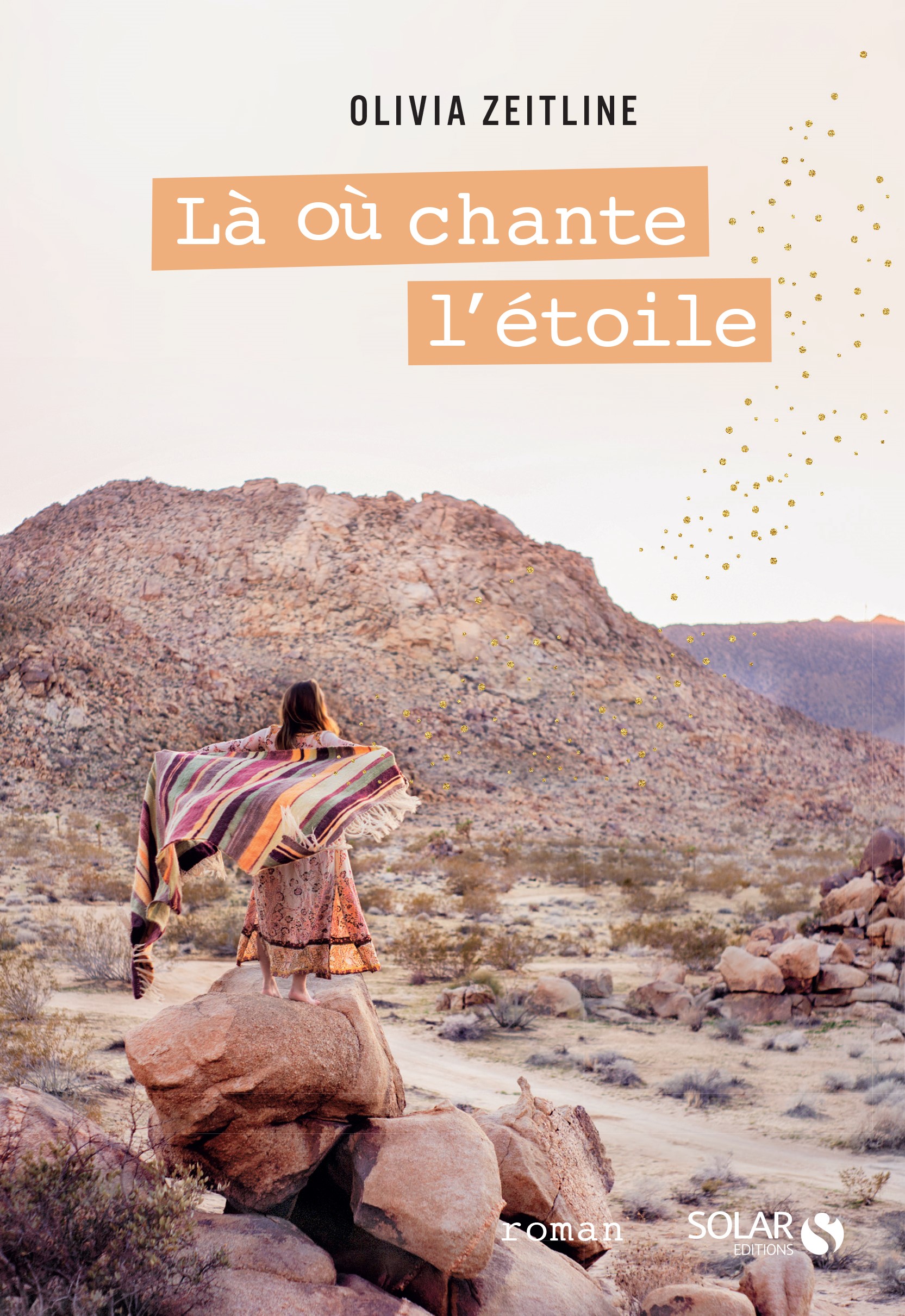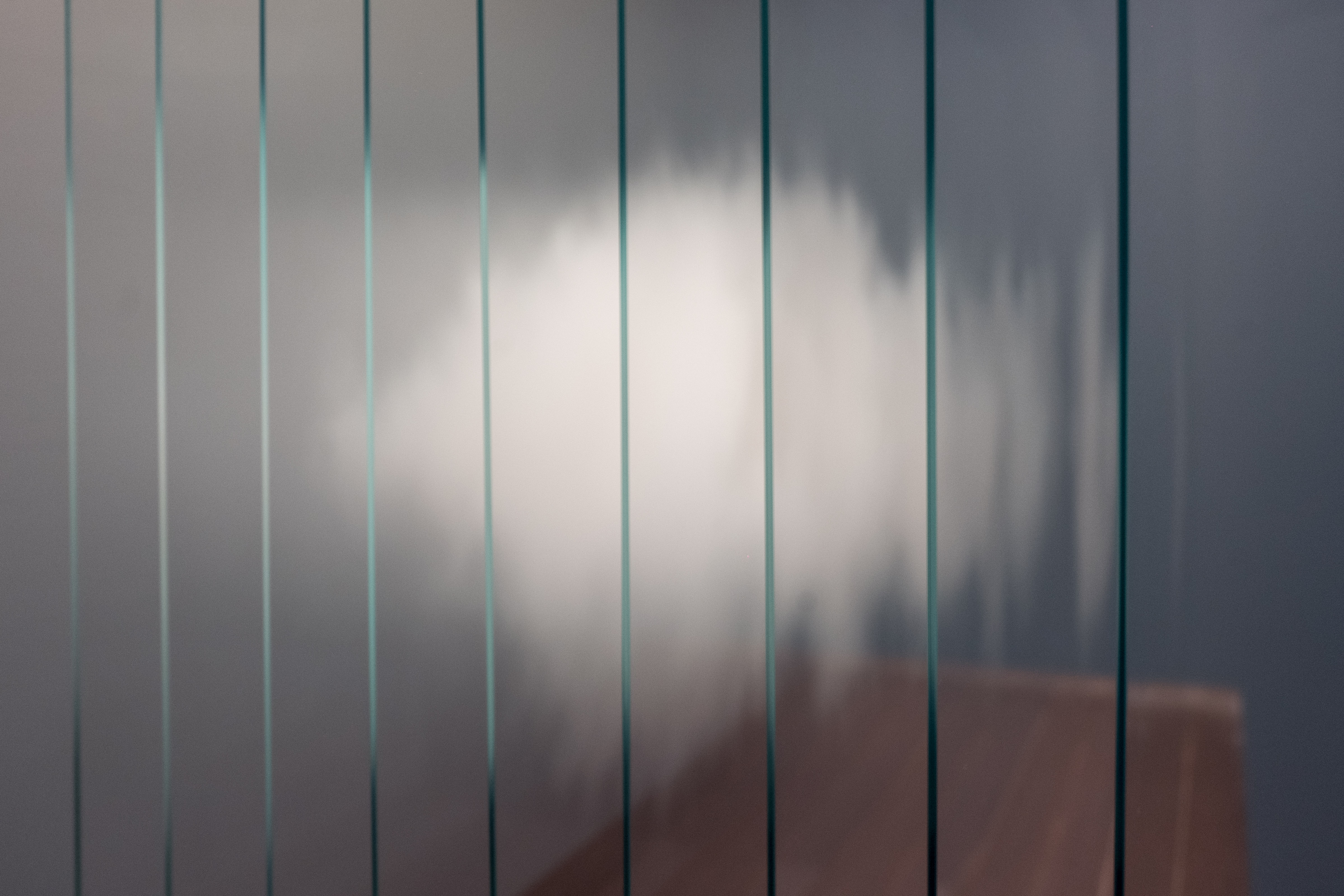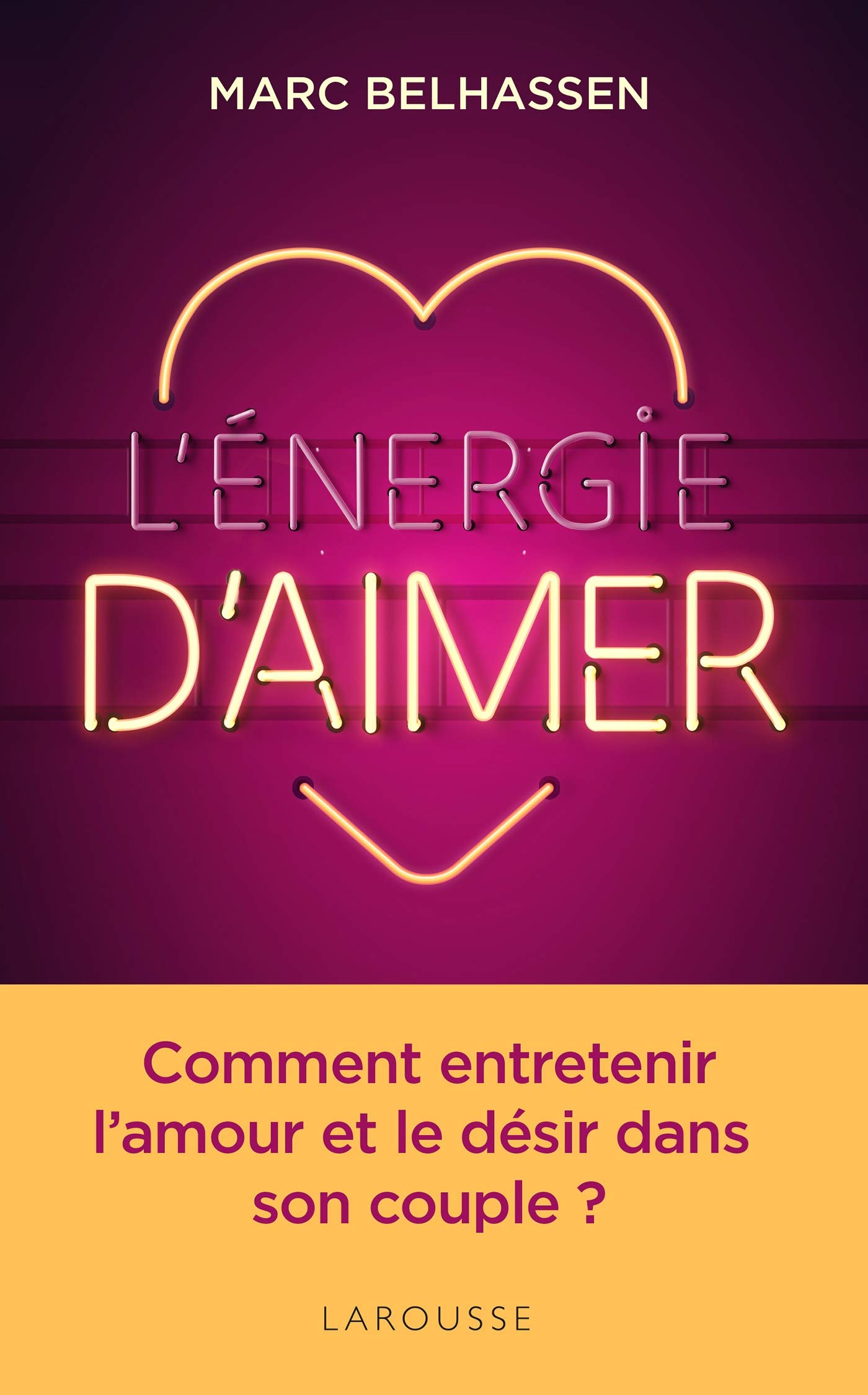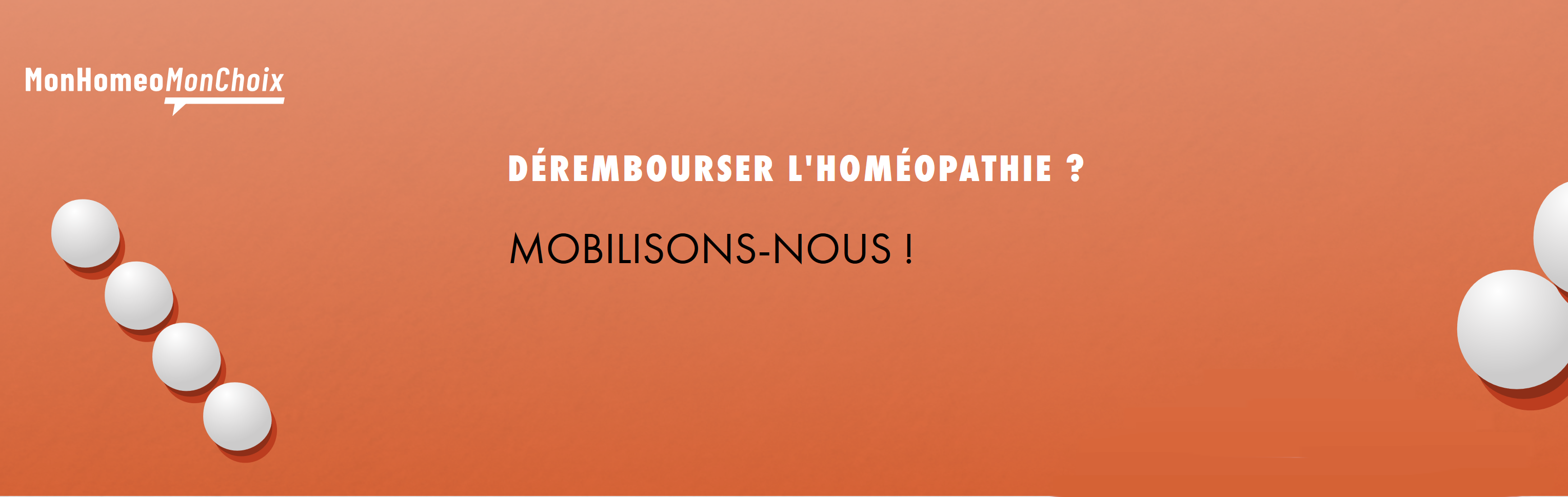Happinez : D’où est né votre intérêt pour le bouddhisme et les maîtres tibétains ?
Reza Moghaddassi : L’horizon de l’existence présenté à la majorité des adolescents réside bien souvent en deux choses : Il y a d’une part l’horizon de la réussite mondaine consistant à mener à bien ses études pour pouvoir avoir un travail qui nous plaise, si possible prestigieux, qui nous permette de vivre confortablement. D’autre part, il y a l’horizon de la jouissance : « profiter de la vie » au sens de mener une vie de fête renouvelée, une vie de voyages et d’aventures aussi exaltantes que nombreuses. La rencontre inattendue de maîtres tibétains à l’âge de 14 ans est venue bouleverser cette double équation : la figure du sage, qui était si exotique et inconnue de mes camarades et de moi-même est devenue, soudain, une figure vivante et inspirante. Elle a dessiné pour moi un nouvel horizon placé non plus sous le signe de l’avoir ou du faire mais de l’être. À côté du chemin horizontal de ma vie, se profilait un chemin plus vertical. J’ai compris à ce moment, à travers quelques témoins vivants, une autre forme de transmission, étrangère à la société et l’école dans lesquelles j’avais grandi : la transmission spirituelle, qui est d’abord une transmission d’être. La deuxième raison de mon engouement est le discours que m’ont tenu ces maîtres tibétains : plutôt que de me pousser à croire à des dogmes, ils m’ont invité à expérimenter la prière et la méditation, le silence et les chants. Plutôt que de chercher à me raisonner, ils m’ont proposer d’entrer dans l’expérience de ce qui est au-delà de la raison et au-delà des mots. Et enfin, plutôt que de m’inciter à devenir bouddhiste, et à adhérer à leur religion qui aurait le monopole de la vérité, ils m’ont conduit à approfondir mes propres racines spirituelles. Je les ai écoutés et je n’ai pas été déçu car j’ai découvert ensuite dans les pratiques spirituelles de l’islam et du christianisme des trésors que je ne soupçonnais pas, ces religions m’ayant été présentées au départ comme une simple affaire d’adhésion ou de non adhésion à des dogmes. J’étais dans l’erreur.
Happinez : Peut-on rapprocher l’acte de philosopher de celui de méditer ?
Reza Moghaddassi : Philosopher, c’est aspirer à la sagesse, c’est-à-dire aspirer à déployer toute la noblesse dont un être humain est capable quand il devient le serviteur du vrai, du beau et du bien. Le travail de la raison est essentiel pour se libérer de certaines illusions. « Tout commence dans la pensée, dit le Bouddha. Quand la pensée est fausse, l’affliction s’ensuit comme la roue de la charrette suit le pas du bœuf ». Ainsi, philosopher, c’est méditer au sens de réfléchir sur. Mais il y a au moins deux autres sens du mot méditation en français que la philosophie a parfois oublié : méditer c’est aussi “ruminer” sa pensée, se laisser habiter par ce qui nous parait juste, de manière à passer d’une compréhension seulement intellectuelle à une compréhension du cœur et des tripes. C’est tout le travail d’incarnation de la pensée qui est aussi une mise en cohérence entre sa pensée et ses actes. Il s’agit de passer de la pensée qu’on a à la pensée qu’on est. Et enfin, méditer, c’est mobiliser une autre caractéristique mystérieuse de la conscience dite réfléchie, c’est-à-dire la capacité à devenir l’observateur de ses propres processus mentaux (sensations, émotions, pensées). C’est apprendre à ne pas s’identifier à ses idées et à ce qu’on appelle trop vite son identité. C’est rencontrer en nous (puis chez les autres) cette dimension qui est plus grande que nos convictions et qui ne se réduit pas à la conséquence de nos actes. C’est partir à la conquête de notre liberté essentielle. C’est aussi mobiliser en nous d’autres forces que le raisonnement, comme par exemple l’intuition. Je ne crois pas que la philosophie puisse conduire à la sagesse si elle ne s’engage pas également sur ce troisième chemin.
« Passer de la pensée qu’on a à la pensée qu’on est. »
Happinez : La méditation est-elle une pratique bouddhiste ou indienne ?
Reza Moghaddassi : Si, par méditation, on entend l’acte qui consiste à devenir l’observateur de ce qui se passe autour de nous et en nous, à se rendre plus présent à ce qui est, notamment par l’attention portée au souffle, comment la méditation pourrait-elle être la propriété de l’Inde ou du bouddhisme ? Il faut commencer par sortir de l’image de la personne assise en lotus à côté d’un bâton d’encens pour revenir à l’expérience universelle de tout être humain. À chaque fois que nous sortons de l’agitation et de l’activisme pour se poser, pour s’accorder un moment d’arrêt et de silence, nous nous voyons lever la tête du guidon, reprendre souffle. Nous voyons ressurgir la question de notre véritable désir et du sens de ce que nous faisons. L’attention nous permet de revenir sur nos intentions. À chaque fois que nous cessons de chercher à posséder, à paraître, faire et avoir et que nous nous mettons à contempler le monde, qu’il s’agisse d’une œuvre d’art, d’un paysage ou d’un visage, nous sentons à quel point nous avons tendance à être trop dans le fonctionnement et pas assez dans l’émerveillement. « Nous mourrons non faute de merveilles mais faute d’émerveillement » a dit très justement Hugo. On appelle alors méditation l’acte qui consiste à susciter ou à arracher dans notre quotidien des moments pour entrer dans cette expérience. Une qualité d’attention au monde peut alors être développée qui va se diffuser naturellement dans le reste de notre journée, y compris au cœur de nos activités et autres engagements. C’est ce qu’on peut appeler, l’intégration de la méditation dans l’action. Le but de cette méditation n’est pas seulement le bien-être mais le déploiement de qualités humaines fondamentales et d’une plus grande aptitude à être dans le monde.
Les traditions religieuses ou spirituelles comme le bouddhisme ont, quant à elles, un horizon métaphysique qui déborde le champ de la méditation comprise comme précédemment. C’est pourquoi elles vont mobiliser des symboles et des images, des sons et des chants, des gestes et des postures, considérées comme sacrées et qui sont censés être le véhicule d’expériences surnaturelles. Elles vont invoquer des forces invisibles aux yeux du corps. Elles ont comme perspective le salut ou la libération du cycle de réincarnation, la résurrection ou l’éveil. Il ne s’agit donc pas du même type de méditation ni de la même finalité. La méditation de pleine présence apparaît du point de vue religieux comme une bonne propédeutique à la vie spirituelle, c’est-à-dire qu’elle nous y prépare. D’un point de vue non religieux, il est tout à fait possible de pratiquer la méditation de pleine présence en dehors de toute adhésion à une perspective métaphysique et religieuse.
Happinez : Pourquoi l’Occident semble-t-il alors découvrir la méditation comme une pratique exotique ?
Reza Moghaddassi : Ces pratiques ont existé vraisemblablement dans les écoles de philosophie antique mais nous n’avons conservé des grecs que des textes. Elles ont également existé dans la tradition chrétienne, dans certains lieux et à certaines époques. Les pères du désert enseignaient, par exemple, des pratiques d’attention au souffle. L’Occident chrétien n’a paradoxalement pas développé, dans son histoire, un rapport toujours apaisé avec le corps et il a eu tendance à délaisser des pratiques qui faisaient partie de son patrimoine.
Mais surtout, le rejet du religieux dans l’histoire de l’Occident a conduit à écarter, en même temps que les dogmes et les institutions religieuses, toute vie intérieure et contemplative, ou du moins à cesser de les penser comme un élément fondamental de l’éducation de l’être humain. Seul a demeuré l’intérêt accordé à l’intelligence rationnelle et conceptuelle, comme en témoigne l’école moderne. La perspective de la sagesse a été remplacée par la perspective du savant. Les conséquences d’un tel délaissement se font de plus en plus sentir au niveau individuel ou collectif, surtout dans une société surmenée par l’obsession de la vitesse, de la rentabilité et de l’efficacité. Dès lors, le détour par des pratiques comme le yoga, le taï-chi ou la méditation sont devenus des moyens pour renouer avec la vie, la santé et un peu plus de paix, là où les structures laïques n’ont que le sport à proposer et les organisations religieuses occidentales qu’une religion avec tout ce que cela implique comme adhésion à un certain nombre de convictions qui ne parlent plus à beaucoup de nos contemporains. Ce n’est pas un hasard si l’engouement pour la méditation est devenu d’autant plus fort aujourd’hui que la méditation dite « de pleine présence » s’enseigne dans des cadres laïques et qu’il n’est plus nécessaire de se rendre dans un temple bouddhiste pour s’y initier.
« Sortir de l’image de la personne assise en lotus à côté d’un bâton d’encens pour revenir à l’expérience universelle de tout être humain. »
Happinez : La méditation de pleine présence est-elle compatible avec la religion chrétienne ou tout autre religion monothéiste ?
Reza Moghaddassi : J’aurais d’abord envie de comparer cette question aux questions suivantes : la foi chrétienne est-elle compatible avec le fait d’apprendre à réfléchir ou à nager ? Il est aussi incongru de poser ces questions que la précédente. Pourquoi ? Parce que les pratiques de pleine présence peuvent d’abord être vues comme des outils pour développer des facultés de notre esprit pouvant être mises au service de sa vie, et pourquoi pas, au service de sa foi, au même titre que le développement de la raison discursive. La chrétienté est habitée par des articles de foi et des pratiques religieuses qui lui sont propres mais ni la foi ni la prière ne font de nous, à elles seules, un être informé et cultivé, capable de raisonnement subtil et riche. L’obscurantisme religieux a toujours vu dans le développement d’une pensée critique un danger pour la foi. Je crois que c’est une même forme d’obscurantisme religieux qui conduit à opposer l’effort pour mobiliser les ressources qui nous habitent et l’action de la grâce, le “travail sur soi” qui caractérise toute voie de sagesse et le saint abandon à la providence divine.
Si la méditation de pleine présence, en tant que pratique régulière, peut être regardée comme un moyen pour développer l’attention, l’intelligence émotionnelle, l’intuition, la connaissance et la maîtrise de soi, elle est aussi, et peut-être plus profondément, une invitation à entrer dans l’expérience gratuite et silencieuse de l’être en tant qu’être, sans raison ni justification. À ce moment, la méditation de pleine présence n’apparaît plus seulement comme une propédeutique à la vie spirituelle mais comme une expérience de cet absolu qui est-delà des mots et des représentations et pourtant toujours présent en tout être et toute chose. Cela nous rapproche peut-être déjà de l’oraison.
J’entends parfois certains me dire qu’ils préfèrent se tourner vers Dieu plutôt que méditer pour justifier leur rejet de la méditation. Préfèrent-ils aussi se tourner vers Dieu plutôt que d’aller voir un film au cinéma, que regarder la route en conduisant, que lire un livre ? Si Dieu existe, il n’est pas toujours en face de nous mais aussi derrière nous ou à côté de nous. L’existence de Dieu et la foi en Dieu ne nous déchargent pas de la responsabilité de prendre en main notre éducation.
Happinez : Mais la méditation n’est-elle pas une pratique égocentrique où on ne fait que rester avec soi-même ?
Reza Moghaddassi : La méditation de pleine présence ne consiste ni à chercher le vide ni à se regarder le nombril. Elle consiste à se rendre présent justement à ce qui est, là où habituellement nous circulons dans le monde et auprès des autres en leur étant en réalité absent. Il s’agit donc de faire l’acte le plus simple, se poser et se taire pour habiter sa vie, habiter l’instant présent. On apprend à être un peu plus dans l’écoute, des autres et de soi-même. C’est d’ailleurs un paradoxe fondamental : plus un être humain s’ouvre à son expérience intérieure plus il s’ouvre au monde et aux autres. À l’inverse, plus on reste à la surface de soi-même, plus on reste superficiel dans sa relation aux autres. Ce paradoxe, on le retrouve d’ailleurs dans toutes les traditions spirituelles qui nous invitent à la fois à nous ouvrir à plus grand que nous et à la fois à jeter l’ancre en soi pour découvrir, comme le dit Saint Augustin, que « si je me connaissais, je Te connaîtrais ». Ce qui est dans l’infini des cieux se trouve demeurer également dans la lumière du cœur.
« Ce qui est dans l’infini des cieux se trouve demeurer également dans la lumière du cœur. »
Happinez : Que peut, à votre avis, apporter la méditation aux jeunes ?
Reza Moghaddassi : Dans un monde soumis à la distraction et l’agitation permanente, la méditation apprend aux élèves à se recentrer (le contraire de “s’éclater”) et à retrouver une plus grande qualité d’attention. Dans un monde où l’on nous traite comme des consommateurs dont on cherche à augmenter sans cesse les besoins, les élèves vont pouvoir renouer avec des désirs plus profonds et avec une plus grande liberté intérieure. Ils vont également apprendre à mieux gérer leur stress. Dans un monde où sans cesse nous jouons des personnages et où nous sommes soumis au poids du regard des autres, la méditation aide à rejoindre la personne et à moins subir le regard des autres. La méditation permet également de développer l’intelligence émotionnelle, c’est-à-dire à reconnaître ses émotions et celles d’autrui, d’être à l’écoute des informations que ces émotions nous transmettent tout en développant la capacité à être moins leurs victimes. Dans un monde qui sans cesse nous évalue, la méditation offre un espace dans lequel l’élève est amené à renouer avec ce qui en lui relève d’une valeur absolue et non d’une valeur relative à ses performances. La méditation permet également de développer des ressources ou des facultés habituellement délaissées, comme l’intuition et la créativité. Inutile d’évoquer les effets de la méditation sur la santé, effets à présent bien connus avec une validation qui n’est plus seulement subjective, mais objective.
Happinez : Il n’est pas toujours simple, même pour les professeurs qui s’y intéressent de près, de convaincre leur administration, et plus généralement l’Éducation nationale, du sérieux de la pratique méditative. Quels arguments utiliser face à une administration qui conserverait des a priori négatifs sur la méditation ?
Reza Moghaddassi : Il faut d’abord remarquer que la méditation n’est pas le lieu d’une transmission de doctrines ou d’une conception du monde mais une invitation faite à un élève de vivre des expériences personnelles qu’il ne s’agit pas de commenter à sa place. Il faut ensuite faire la démonstration la plus concrète de la dimension laïque de ce type de pratiques. C’est pourquoi il est essentiel de dépouiller l’enseignement de la méditation des symboles hérités des cultures orientales pour mettre en lumière sa dimension universelle. D’autre part il faut bien préciser qu’il ne s’agit en rien de faire une investigation d’ordre psychologique. Ces questions relèvent de la compétence de professionnels. Il faut également rappeler les objectifs précis de ce type de propositions : développement de l’attention et de l’intelligence émotionnelle, gestion du stress, développement de la bienveillance et de la confiance en soi.
Il y a deux volets à ces pratiques à l’école :
- un usage de la méditation au service de la pédagogie. Par exemple faire un petit temps de pratique avant le début des cours pour mieux mobiliser l’attention des élèves.
- Un usage de la méditation pour proposer une vision plus large et plus riche de l’éducation du futur adulte et citoyen.
Le but de l’école est de former des citoyens plus libres, notamment grâce au développement de la raison critique et l’acquisition de connaissances. Or, nous savons que l’homme est autant un être émotionnel qu’un être rationnel et que la manipulation et la démagogie s’appuient bien souvent sur ce ressort passionnel. C’est pourquoi, pour élargir le champ d’exercice de la liberté, l’école doit également offrir la possibilité à l’élève d’être davantage maître de ses émotions en commençant par cesser de les refouler et les reconnaître.
Enfin, il faut insister sur l’urgence aujourd’hui de ce que certains appellent une “écologie de l’attention”. De même que notre vie sédentaire nous a conduit à faire du sport pour rester en bonne santé, l’usage omniprésent du smartphone et d’autres sources de distractions qui hachent et dispersent sans cesse l’attention produit une fatigue psychique qui exige son antidote.
« Cette vie n’est pas un dû mais un don. »
Happinez : De quelle manière peut-on répondre à cet appel de notre intériorité que vous évoquez dans votre livre La soif de l’essentiel (Marabout) ?
Reza Moghaddassi : En commençant par se rendre justement plus attentif à toutes les expériences qui nous ont rendu plus vivants, à ces instants de grâce où un regard d’amour, la beauté d’un paysage ou la splendeur d’une musique nous ont arrachés à l’enchaînement quotidien. Là est le point de départ, qui est une expérience et non une croyance ou une idée. Lorsque nous nous mettons au diapason de telles expériences, un élagage se produit dans notre existence et nous apprenons alors la valeur de la sobriété. Un vent de gratitude peut alors se lever pour cette vie qui n’est pas un dû mais un don. Ce qui a été enfin reçu veut alors être offert, c’est pourquoi la soif de l’essentiel nous conduit à mettre notre vie au service de plus grand que nous, à commencer au service du Bien/Aimé, non par obligation mais par choix et dans la joie.
Propos recueillis par Aubry François
Portrait © Astrid di Crollalanza